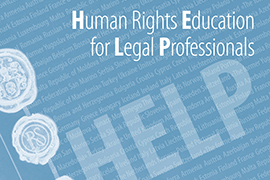Le Protocole n° 15 sera ouvert à la signature le 24 juin 2013, à Strasbourg. Il est le fruit direct de la Conférence à haut niveau sur l’avenir de la Cour, qui s’est tenue à Brighton en avril 2012 et qui elle-même se situait dans le droit fil des Conférences d’Interlaken et de Brighton.
Il présente plusieurs caractères semblables à ceux du Protocole n° 14. D’abord, il s’agit d’un protocole d’amendement, même si plusieurs de ses dispositions sont des ajouts au texte originel. Ensuite, il s’agit d’un instrument obligatoire, puisqu’il ne pourra entrer en vigueur qu’avec l’accord de chacun des quarante-sept Etats membres du Conseil de l’Europe. Enfin, il s’agit d’un texte hétérogène, car il traite de questions dépourvues de véritable rapport entre elles.
Le Protocole n° 15 diffère cependant du Protocole n° 14 en ce qu’il n’a pas la même ampleur. En effet, il ne modifie pas le système de contrôle établi par la Convention quant à ses institutions et il porte sur des points relativement secondaires ou accessoires.
Dans ces conditions, quel intérêt le Protocole n° 15 a-t-il pour les praticiens du droit, soucieux de donner corps aux droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles additionnels ?
Les juges et les procureurs ne manqueront pas d’être frappés par l’ajout d’une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation dans le préambule de la Convention. Outre son caractère historique – le préambule n’avait jamais été retouché depuis 1950 -, cet ajout revient à graver dans le marbre d’un traité international des notions bien ancrées dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Il révèle le souci, voire l’inquiétude, des Etats face à l’étendue du pouvoir de contrôle de cette dernière, et conforte la responsabilité première des autorités nationales. Sa valeur symbolique l’emporte à l’évidence sur sa portée pratique.
Il n’en va pas de même de l’amendement du critère de recevabilité concernant le« préjudice important », lequel consiste à supprimer la seconde condition empêchant le rejet d’une affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. On peut s’étonner qu’il ait fallu remettre sur le métier un dispositif fonctionnant seulement depuis le 1er juin 2010, mais on peut aussi y voir la confirmation des craintes ou des doutes qu’il suscitait à l’époque de l’élaboration du Protocole n° 14. La maxime de minimis non curat praetor devrait donc jouer davantage, non seulement à Strasbourg – telle est clairement l’intention des Etats -, mais aussi devant les juridictions nationales.
Quant aux avocats, ils seront certainement attentifs à deux nouveaux éléments. Le premier, de très loin le plus important, est la réduction de six à quatre mois du délai dans lequel une requête doit être introduite devant la Cour. Cette mesure est inédite, dès lors que le délai originel était resté intouchable, mais a pour origine une suggestion de la Cour elle-même. Elle peut sembler drastique : le délai est réduit d’un tiers ! Surtout si l’on sait que bien des avocats attendent le tout dernier moment pour saisir la Cour. On doit pourtant admettre que la durée en cause reste très supérieure aux délais de recours existant pour la plupart des cours suprêmes et des cours constitutionnelles en Europe. Quoi qu’il en soit, les avocats devront faire preuve d’une vigilance accrue, à commencer par ceux qui ont une longue pratique de la procédure européenne.
Le second élément est la suppression du droit des parties à une affaire de s’opposer au dessaisissement d’une chambre au profit de la grande chambre. En la matière, l’expérience depuis le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11, montre que dans l’immense majorité des cas l’opposition au dessaisissement vient des gouvernements et non des requérants et de leurs conseils. Le rapport explicatif sur le Protocole n° 15 prend cependant soin de préciser qu’« il est attendu de la chambre qu’elle consulte les parties sur ses intentions ».
En conclusion, le Protocole n° 15 laisse une impression de modestie, en se contentant – sauf pour le délai de recours – de simples retouches à la Convention. Il ne devrait donc pas bouleverser les modes d’exercice et les obligations des praticiens du droit en Europe. Il n’en ira sans doute pas de même du Protocole n° 16, un protocole facultatif qui est en cours d’adoption – il devrait voir le jour en 2013 - et qui vise à donner à la Cour le pouvoir de rendre sur demande des avis consultatifs sur l’interprétation de la Convention dans le contexte d’une affaire particulière au niveau national.
Vincent BERGER
Ancien jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme