Chapitre II : Processus et acteurs
Dans l’Europe contemporaine, au moins trois grands modèles de démocratie circulent parmi les théoriciens et les praticiens. Chacun de ces modèles confie la responsabilité première à des acteurs et à des processus décisionnels différents. Pour guider notre réflexion collective sur les défis et les perspectives qui se présentent à ces acteurs et à ces processus, nous nous proposons d’utiliser une définition générale de la démocratie qui ne renvoie à aucune structure institutionnelle ni à aucune règle précise en matière de décisions. En laissant ouvertes les questions capitales de savoir comment les citoyens choisissent leurs représentants, quels sont les mécanismes de responsabilisation les plus efficaces et comment sont prises les décisions collectives à caractère contraignant, cette définition n’invalide pas ce que nous appellerons par la suite démocratie « numérique », « négociatrice » ou « délibérative ».
La démocratie politique moderne est un régime ou un système de gouvernance dans lequel les dirigeants sont tenus responsables de leurs actions dans la sphère publique par les citoyens, qui agissent indirectement en jouant de la concurrence et de la coopération de leurs représentants.
Cette définition nous permet une division tripartite du travail. Trois types d’acteurs se conjuguent par le biais de multiples processus pour produire le summum bonum de la démocratie politique, à savoir la responsabilité. Nous avons donc divisé nos analyses des transformations et des réponses contemporaines selon qu’elles touchent la citoyenneté, la représentation ou la prise de décisions.
La citoyenneté
Le mécontentement politique
Aujourd’hui, l’un des traits saillants des démocraties européennes est un sentiment de mécontentement politique, de désintérêt, de scepticisme, d’insatisfaction et de cynisme apparemment général dans la population. Ces réactions ne sont pas dirigées, ou pas seulement, contre tel ou tel parti, gouvernement ou politique. Elles procèdent de perceptions critiques, voire hostiles, que les citoyens ont des responsables politiques, des partis, des élections, des parlements et des gouvernements en général, d’un bout à l’autre du spectre politique.
Le mécontentement politique se manifeste dans des opinions, des attitudes et des actes. Certains citoyens laissent libre cours à leur déception ou à leur colère dans leurs conversations quotidiennes avec leurs amis ou leur famille. Des spécialistes en sciences sociales tentent d’analyser ces opinions par des sondages ou des entretiens approfondis. Plus ces opinions ou ces attitudes sont extrêmes, plus elles ont de chances de se traduire en actes réels. Dans le domaine politique, ces actes sont souvent des « non-actes ». De nombreux citoyens en proie à la déception ou à la colère s’abstiennent de voter ou d’adhérer à un parti politique. D’autres expliquent qu’ils sont si furieux contre les partis (traditionnels) et leurs responsables qu’ils ont l’intention de voter pour un outsider, ou un parti protestataire ou radical. Les électeurs mécontents feront donc plus souvent preuve d'instabilité dans leurs choix électoraux, ce qui explique en partie la fréquence sans précédent des alternances gouvernementales.
Qu’elles s’expriment dans des conversations, des sondages ou des entretiens, les opinions peuvent être (plus ou moins) fragiles, volatiles, conditionnées par le contexte et même artificielles. C’est pourquoi les actes sont plus importants que les mots. Même si la participation électorale est déterminée par de nombreux facteurs et ne reflète pas uniquement la satisfaction ou le mécontentement politique, son évolution peut être révélatrice de l'étendue et de la progression de ce mécontentement.
Figure 1 : Participation aux élections législatives en Europe occidentale et orientale

La figure 1 mesure l’évolution de la participation annuelle moyenne aux élections législatives dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe depuis 1980. Elle s’appuie sur les données électorales des Etats membres dont la population est supérieure à un million d’habitants et qui étaient membres du Conseil de l'Europe avant 1980 (Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni). Ce regroupement est bien évidemment artificiel mais il illustre la tendance globale à la baisse de la participation électorale en Europe et, partant, le mécontentement politique apparemment croissant qui détermine en partie la participation de l’électorat. Les données pour l’Europe centrale et orientale ont été traitées de manière analogue et prennent en compte la participation des électeurs aux élections législatives dans sept pays (Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République slovaque). Ces pays ont été choisis parce qu’ils ont une population supérieure à un million d’habitants et qu’ils sont membres du Conseil de l'Europe depuis plus de dix ans, à compter de 1990.
La participation « européenne » a diminué, passant de 88 % en 1980 à 74 % en 2002, et même à 70 % en 2000. La participation électorale baisse, plus ou moins rapidement, dans tous les pays à l’exception du Danemark. Si nous extrapolons la tendance globale passée, la participation sera d’environ 65 % en 2020, voire plus faible si nous tenons compte de la population en âge de voter et non des électeurs inscrits. Le déclin de la participation électorale est encore plus marqué en Europe centrale et orientale. Dans cette région, la participation moyenne pondérée des électeurs est passée d’approximativement 70 % au début des années 90 à 60 % dix ans plus tard. Elle sera d’environ 45 % au début des années 2020 si nous extrapolons son évolution sur cette brève période. Ces conclusions sont étayées par des sondages d’opinions qui montrent une nette tendance à la perte de confiance dans le pouvoir législatif en Europe.
Les positions à l’égard du monde politique sont toutefois plus ambivalentes que les expressions de mécontentement pourraient le faire penser. Les partis et responsables politiques nationaux, c'est–à-dire les acteurs politiques spécialisés et professionnels, sont bien plus la cible des critiques que les responsables locaux. A d’autres égards, les gens font des distinctions entre différents niveaux politiques. Certains d’entre eux, appartenant surtout à la bourgeoisie et aux couches socioculturelles supérieures, voient des différences entre l’aspect « politicien » qui renvoie aux partis, aux responsables, aux élections, aux rivalités et aux luttes de pouvoir, et un aspect non, ou moins, « politicien » associé à des projets, des programmes, des questions, des idées, des principes, des convictions et des efforts pour résoudre les problèmes. Lorsque les personnes appartenant à cette catégorie critiquent la politique, elles pensent généralement (et tacitement) à la première dimension. Certains de ces citoyens parmi les plus critiques sont disposés à croire en la politique lorsqu’un dirigeant ou un parti leur semble « différent » ou lorsque des questions primordiales (terrorisme, fascisme, Etat-providence) sont en jeu.
La manière dont est perçu et critiqué le monde politique dépend de l’investissement et des compétences politiques de chacun. Deux types de mécontentement doivent être distingués : un mécontentement plutôt simpliste et intemporel et un autre plus subtil. Le premier existe depuis longtemps, bien avant que les responsables politiques et les spécialistes en science politique aient commencé à s’inquiéter de la méfiance inspirée par les institutions et les acteurs politiques. Il est plus ancien que les transformations politiques (par exemple, la mondialisation, les « délocalisations », la « crise » de l’Etat-nation, la montée du chômage, l’intégration européenne) souvent avancées pour expliquer le désintérêt pour la politique. Le mécontentement de ce type est facilement – peut-être trop facilement – repéré par les sondages d’opinion. Les personnes interrogées qui partagent ces opinions appartiennent, du moins statistiquement, à des tranches bien définies de la population qui se caractérisent par :
– un niveau assez faible (quoique variable) d’instruction, de statut social, d’information et de subtilité politiques, et un sentiment d’incompétence personnelle en la matière ;
– une absence de préférence politique marquée et même une incapacité à percevoir des différences entre les responsables et partis politiques ;
– la peur de « se faire avoir » par le monde politique à cause de cette incompétence ;
– un manque d’intérêt pour la politique qui les amène à penser et à affirmer que celle-ci ne mérite pas leur attention ;
– une vision étroite de la politique, réduite à sa dimension « politicienne », qui résulte de ce désintérêt pour la chose publique et qui s’en nourrit;
– de mauvaises conditions de vie qui les conduisent à penser que les hommes politiques ne s’occupent pas vraiment d’eux et que la politique n’a donc aucune importance.
Dans le même temps, d’autres personnes expriment un mécontentement plus subtil. Contrairement à celles de la catégorie précédente, elles se réfèrent à divers changements intervenus dans le domaine politique. Par exemple, elles affirment qu’« il n’y pas beaucoup de différence entre les partis politiques aujourd’hui », que « les partis de gauche et de droite sont actuellement très semblables et mènent les mêmes politiques », que « la politique est de plus en plus tiède », que « la politique n’a plus d’importance, c’est l’économie qui compte maintenant », que « les Etats-nations ne peuvent pas faire grand chose contre les entreprises qui décident de délocaliser » ou que « c’est l’Union européenne qui décide de tout ». Les personnes qui défendent ces opinions ajoutent qu’elles s’intéressent beaucoup moins à la politique qu'auparavant et que leurs préférences politiques se sont émoussées. Pourtant, nombre d’entre elles ont encore de fortes aversions, en ce sens qu’elles sont fermement opposées à certains partis politiques. Elles s’intéressent encore assez à la politique pour pouvoir en critiquer les acteurs à l’aide d’arguments bien étayés. Les personnes qui peuvent être classées dans cette deuxième catégorie ont un meilleur niveau d’instruction (mais pas obligatoirement très élevé). Elles sont plus intéressées, plus informées et plus confiantes dans leurs capacités à maîtriser la politique que celles de la première catégorie, et en ont une vision plus complexe, plus diachronique et plus noble.
Causes du mécontentement politique
Le mécontentement politique procède d’un ensemble de facteurs convergents.
Education. Plus le niveau d’instruction est élevé, plus le sentiment de compétence politique est fort. Plus les compétences subjectives et objectives sont grandes, plus les aptitudes et les tendances à la critique le sont aussi. L’amélioration des compétences cognitives chez les citoyens accroît leur capacité et leur disposition à critiquer ce qu’ils désapprouvent. Une communauté de citoyens plus éduqués a un esprit plus critique et elle est potentiellement plus exigeante avec ses dirigeants et représentants politiques. Les citoyens plus instruits souhaitent aussi tacitement être plus actifs, même s’ils ne sont pas prêts à investir du temps et de l’énergie lorsqu’on demande effectivement leur participation. La demande de formes plus tangibles et directes de participation politique est donc réelle bien que quelque peu ambiguë. Avec pour conséquence concrète, peut-être, une diminution inéluctable de l’importance des élections comme forme majeure de la participation démocratique. Un nombre faible mais croissant de citoyens (relativement) instruits demandent plus ou moins clairement à avoir davantage de possibilités d'exprimer leurs opinions et de trancher eux-mêmes des questions importantes.
Transformation des valeurs. Les communautés de citoyens européens, ou au moins une grande part de celles-ci, semblent être passées de la déférence envers l’autorité et les autorités, au scepticisme à l'égard des élites et des institutions. Pour des raisons nombreuses et complexes, la permissivité et l'intolérance aux normes sociales et à l’autorité gagnent depuis longtemps du terrain. La culture des droits, de l’égalité, et de l’autonomie personnelle qui progresse est assez antinomique avec la déférence, le respect, la discipline, la hiérarchie et l’autorité qui organisent les relations citoyens-représentants dans une démocratie représentative.
Changements économiques. La croissance économique a été faible au cours des trente dernières années. Le chômage a augmenté, les salaires réels sont restés stables ou n’ont progressé que lentement au fil des ans. Le fléchissement des barrières commerciales, la baisse des coûts de transport et l’amélioration des communications ont renforcé le rôle du commerce et des investissements internationaux dans toutes les économies. La compétition mondiale amène divers avantages à certaines catégories, mais entraîne aussi la délocalisation d'entreprises dans des pays à faibles salaires, une baisse des salaires dans les pays avancés et des pressions concurrentielles tendant à tirer les normes du travail vers le bas. Les nouvelles technologies ont un effet destructeur sur la main d’œuvre spécialisée et ses salaires, même si elles peuvent créer en même temps de nouveaux emplois qualifiés. La mondialisation a remis en cause la capacité des Etats à mettre en place une régulation efficace dans le domaine économique et social. De nouvelles institutions comme l’Union européenne ou l’Organisation mondiale du commerce ont réduit la marge de manœuvre politique des Etats-nations. Elles ont aussi laissé penser que ceux-ci pouvaient devenir un acteur collectif de moindre importance. Les Etats-nations sont également vidés de leurs pouvoirs par la déréglementation et la privatisation. Dans le même temps, les gouvernements, confrontés à une « crise fiscale », ont tenté d’équilibrer leurs budgets en jugulant les dépenses du secteur public. Les services sociaux ont été réduits ou leur expansion a cessé.
Les citoyens se trouvent de plus en plus souvent aux prises avec des problèmes qui découlent de la compétition mondiale, de la crise économique et de la diminution de la protection sociale. Ceux qui subissent ou craignent le chômage personnellement ou dans leur famille et ceux qui pensent que leur situation économique va empirer, sont plus enclins à une perception négative de la politique. Les personnes qui pensaient déjà que la politique ne pouvait pas améliorer leur vie et qu’il n’y avait rien à attendre des responsables politiques ont vu leur opinion confirmée.
Les fléaux « objectifs » ou « imaginaires » comme la récession, l’augmentation de l’immigration, la perte du contrôle local, le chômage et l’insécurité, ont amené certaines parties de la population, qu’elles soient personnellement touchées ou non et indépendamment des réalisations accomplies dans d’autres domaines, à conclure que le gouvernement ne s’attaquait pas bien aux problèmes et ne tenait pas ses promesses.
Pour des tranches plus averties de la population, le niveau de mécontentement politique est aussi lié à des évaluations plus complexes des résultats des gouvernements. La prospérité liée aux politiques économiques menées au cours des trente premières années qui ont suivi la Deuxième guerre mondiale puis le renversement de conjoncture au milieu des années 70 ont suscité des attentes, ensuite déçues, sur la capacité de l’Etat à s’occuper de la croissance, de l’inflation et de l’emploi. Les performances économiques médiocres ou plus médiocres des pays au cours des dernières décennies ont apparemment été évaluées par rapport au boom économique des « Trente glorieuses » de l’après-guerre et à l’aune des attentes créées par un siècle d’interventions publiques de plus en plus importantes.
Les tranches les plus averties de la population sont davantage conscientes des changements économiques et sociaux des dernières décennies. Elles ne raisonnent pas comme si rien n'avait bougé. Selon elles, l’Etat-nation n’est plus capable de faire face aux grandes difficultés économiques, il ne peut pas s’opposer aux décisions des entreprises internationales et empêcher les délocalisations des usines. Leurs attentes concernant les possibilités d’action des gouvernements ne sont plus aussi élevées. Toutefois, elles restent déçues par la politique parce qu’elles comparent tacitement les performances actuelles des gouvernements avec leurs performances antérieures, ou avec les visions normatives qu’elles se sont faites de ce que devraient faire les gouvernements. Les attentes normatives et idéologiques produisent donc des capacités critiques, mobilisées par ce qui apparaît comme des échecs des gouvernements. La conjonction de capacités critiques développées par une meilleure éducation et de nombreuses déceptions politiques, nourrit une disposition permanente à la critique dans les couches politisées de l’opinion. Ces tendances critiques sont mobilisées lorsque les personnes en question sont confrontées à des difficultés personnelles, quelles qu’elles soient.
Contexte politique. Pour justifier leur déception vis-à-vis de la politique, les gens évoquent divers éléments des contextes sociaux et politiques. On constate que les révélations spectaculaires de corruption politique et les scandales qui ont eu lieu dans de nombreux pays, ont favorisé un climat de méfiance d'ordre éthique.
Les écarts idéologiques et politiques entre les partis politiques ont diminué. Dans plusieurs pays européens, la politique n’est plus considérée, comme elle l’était jusqu'ici, comme une lutte entre des visions opposées, et même utopiques, de la société et de son avenir. Depuis la chute du système socialiste « réel », presque aucun parti établi n’a l’intention de renverser l’économie de marché, le capitalisme et la démocratie libérale. Pour différentes raisons mentionnées précédemment, la marge de manœuvre des gouvernements s’est aussi amenuisée. Cela a amené certaines parties de l’opinion publique à conclure que la politique n’a plus d’importance, qu’il est inutile de perdre du temps à trancher entre des partis semblables défendant des politiques semblables, et que les partis et les responsables politiques n’entrent en compétition que pour consolider leurs propres pouvoirs et privilèges. Ceux qui ont gardé certains attachements partisans regrettent profondément que les partis de gauche soutiennent ce qu’ils considèrent comme des politiques « néolibérales de droite » ou que les partis de droite ne modifient pas les politiques « socialistes de gauche » lorsqu’ils sont au gouvernement. Certains citoyens estiment que la politique a perdu de son authenticité et qu’elle est de plus en plus régie par l’intérêt personnel et les arrière-pensées. Ils accusent parfois les sondages d’opinion et les spécialistes de la communication d'être à l'origine de ces changements.
Des épisodes récurrents de la vie politique, qui étaient perçus comme neutres ou normaux dans le passé, alimentent aujourd’hui une méfiance assez importante pour produire une prévention contre la politique elle-même. Les attaques, dénigrements et critiques répétés de représentants élus et choisis à l'égard du « gouvernement » contribuent à développer des perceptions de plus en plus négatives dans l’opinion publique, déjà encline à réduire la politique au jeu « politicien ».
En général, pour augmenter leur audience, les médias simplifient, personnalisent, dramatisent et mettent en avant les aspects « spectaculaires » des événements politiques. Ils s'intéressent à la politique plutôt qu'aux orientations politiques, privilégient les scandales, la tactique et les rivalités personnelles et suivent les campagnes électorales comme il s’agissait de courses de chevaux. Les candidats et les hauts responsables sont souvent dépeints comme fourbes et intéressés. Les médias renforcent souvent les craintes et les préjugés de la partie de leur public qui ravale la politique au jeu politicien, ne serait-ce que parce que l’information est ainsi plus amusante et plus facile à comprendre. C’est particulièrement vrai des « citoyens-consommateurs » qui ne sont que très superficiellement intéressés par le sujet et déjà enclins à se méfier de la politique en raison de leurs prédispositions, de leur marginalité sociale et de la suspicion dans laquelle ils tiennent les institutions.
Le mécontentement politique a-t-il de l’importance ?
La montée apparente du mécontentement politique menace-t-elle la légitimité des systèmes politiques européens ? Disons d’emblée que le mécontentement politique est ambivalent et que le désenchantement actuel n'est pas irréversible. Ajoutons que si l’on constate une diminution d'ailleurs ambivalente de la confiance dans les responsables, les partis politiques, les élections, les parlements et les gouvernements, la méfiance ne semble pas avoir gagné pour autant les autres sphères des systèmes européens. La légitimité d’un régime politique dépend de l’existence d’un autre régime ou d’une utopie concurrents. Or, l'affrontement entre les différentes formes d’organisation gouvernementale et sociale a disparu au moins depuis 1989. Selon certains chercheurs, depuis la chute du système socialiste, l’adhésion des citoyens à la démocratie dépend de plus en plus des résultats du gouvernement, particulièrement dans les ex-pays socialistes. Les systèmes démocratiques semblent donc plus vulnérables, mais ils sont en même temps incontestables et plus forts.
Pour ces mêmes raisons, le taux élevé et croissant d’abstention électorale n’est pas en lui-même une menace pour le système politique. Mais, dans la mesure où l’abstention augmente dans les couches défavorisées de la société et où les responsables politiques sont plus disposés à prendre en compte les attentes des électeurs que celles des non-électeurs, la chute de la participation électorale devrait contribuer à introduire ou à renforcer la discrimination sociale dans les politiques publiques.
Avec la méfiance dans les institutions politiques, se pose la question de la volonté de la population de respecter les lois, de payer les impôts ou de faire carrière dans l’administration. Plusieurs actes de violence isolés perpétrés dans certains pays contre des responsables politiques et des fonctionnaires pourraient être liés à l'exacerbation du mécontentement politique. La méfiance d'ordre éthique à l'égard des responsables politiques est déjà un grave problème car elle incite à enfreindre les règles et la loi. Des jeunes délinquants affirment, par exemple, qu’ils n’ont pas honte de leurs vols, cambriolages ou trafics de drogues parce que « les dirigeants politiques volent bien plus que nous ».
Identité culturelle et protestation
Les migrations, que l’on peut définir comme le déplacement de personnes d’une région ou d’un pays à un autre, indépendamment de leurs motivations, donnent lieu à d’importants changements démographiques qui ont des répercussions sur la vie démocratique en Europe. L'immigration diversifie la composition du demos européen en entraînant la cohabitation, sous le même toit démocratique, de personnes ayant des statuts juridiques différents. Les ressortissants nationaux côtoient des immigrés temporaires, des résidents étrangers de longue durée (ou denizens), des demandeurs d’asile et des immigrés sans-papiers. Du fait de leur statut juridique, ces groupes ont des obligations et des droits différents.
Démocratie, citoyenneté et droits
a) Ampleur et caractéristiques des migrations
Depuis 1989, l’immigration nette est le principal facteur influant sur l'évolution démographique annuelle des Etats membres du Conseil de l'Europe. La figure 2 ci-dessous présente l'évolution de la population étrangère en pourcentage de la population totale pour 15 pays d’Europe. La population étrangère totale enregistrée était d’environ 21 millions de personnes en 1999, ce qui représentait quelque 2,6 % de la population totale de l'ensemble des pays. D’après les données, c'est la Suisse qui comptait en 1999 la proportion la plus élevée d’étrangers par rapport à la population totale du pays (19,3 % d'étrangers dont deux-tiers de ressortissants de l’Union européenne). La population étrangère réside en majorité en Europe occidentale tandis qu’en Europe centrale et orientale, la proportion d'étrangers est relativement faible (moins de 2 %). L’immigration intérieure nette dans les deux régions était relativement élevée au début des années 1990, l’augmentation absolue la plus importante touchant la République Fédérale d’Allemagne. A la fin des années 1990, la proportion d'étrangers a baissé ou s’est stabilisée dans certains pays d’Europe occidentale. Elle a cependant augmenté dans la plupart des pays depuis 1998, bien que faiblement en Europe centrale et orientale (les chiffres les plus élevés enregistrés dans les PECO concernent la République tchèque). D'après les données dont nous disposons, en Europe occidentale, la diversité d’origine des migrants étrangers est considérable et la majorité des étrangers viennent de pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen (EEE) plus la Suisse. Les migrants étrangers choisissent des pays de destination différents, selon leur pays d'origine. Par exemple, l’Afrique est une source importante d'immigrés pour la France, de même que l’Amérique latine pour l’Espagne et le Portugal. Les Asiatiques immigrent dans différents pays d’Europe, pour diverses raisons : ceux qui viennent du sous-continent indien se rendent en général au Royaume-Uni, les Philippins en Italie pour des emplois temporaires, et la Grèce accueille une immigration originaire du Proche-Orient. L’Allemagne est la destination la plus fréquente des ressortissants des pays européens extracommunautaires. Les migrants temporaires et de transit représentent aussi une population importante en Europe centrale et orientale.
Figure 2 : La population étrangère en pourcentage de la population totale de quelques pays du Conseil de l'Europe, 1980-2020
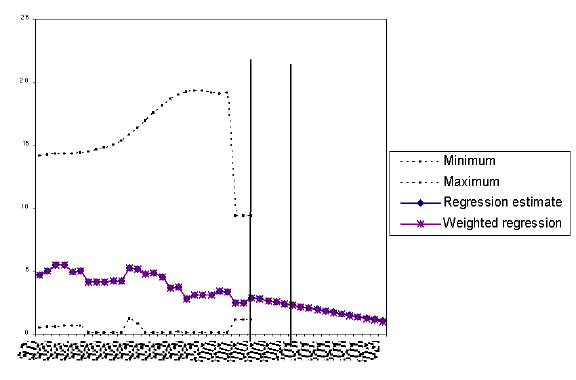
Sources: Les estimations sont tirées des données des annuaires du Conseil de l’Europe, de l’OCDE SOPEMI “Tendances des migrations internationales, 2003”, Salt, J., 2001; “Evolution actuelle des migrations en Europe”, Conseil de l’Europe; Wanner, P., 2002; “Tendances migratoires en Europe”, European Population Paper Series No. 7. La population étrangère est prise en compte par les données, en pourcentage de la population totale. En effet, les pays comptant le plus grand nombre de résidents étrangers n’ont pas obligatoirement la plus forte proportion de résidents étrangers.
L'Europe, à partir de la fin des années 1950, a activement recruté à l'étranger des travailleurs migrants qui ne devaient pas s'installer de manière permanente dans le pays d’accueil. Le recrutement de main-d’œuvre étrangère a effectivement cessé dans les pays d'Europe occidentale depuis la moitié des années 1970. Toutefois, la population étrangère n’a pas diminué, à cause du faible nombre de retours et du regroupement familial. De nombreux travailleurs immigrés ont obtenu le statut de « résidents non-citoyens ». Cette catégorie de personnes, souvent appelée « denizens » (résidents étrangers de longue durée), bénéficie d’un statut intermédiaire entre nationaux et étrangers. Ces résidents sont intégrés dans les diverses structures sociales, économiques et juridiques sans toutefois bénéficier de l'intégralité des droits à la participation politique. Les règles pour accorder le statut de résident étranger (« denizenship ») et les droits et les avantages attachés à ce statut, varient d’un pays à l’autre. Toutefois, le statut de résident étranger est devenu un élément fort et stable de toutes les démocraties du Conseil de l'Europe, ce qui a conduit à réexaminer la question de savoir qui a le droit de participer à la vie politique et sous quelle forme.
b) Statut de résident étranger et nationalité
La continuité entre le peuple et le lieu, la nationalité et le demos, est un postulat essentiel des démocraties modernes. La citoyenneté de l’Union européenne illustre magistralement comment les frontières de l’appartenance politique peuvent être élargies et comment le demos peut s’étendre au-delà des frontières nationales. Toutefois, même dans les Etats membres de l’Union européenne, les ressortissants de pays tiers ne bénéficient pas du statut complémentaire de la citoyenneté de l’Union européenne, tel que défini par le Traité de Maastricht. Jusqu’à présent, les mesures prises pour étendre les droits de la citoyenneté au-delà des nationaux, n’offrent donc pas un cadre global pour traiter les questions concernant la participation politique des ressortissants de pays tiers. Cela nous invite à réfléchir avec imagination à la composition de l’électorat, à la citoyenneté et aux mécanismes de la participation politique.
De fait, dans l’Union européenne, des droits civils et sociaux ont aussi été accordés aux ressortissants de pays tiers. Cette tendance montre que la nationalité n’est plus la voie exclusive pour accéder aux avantages que donne l’appartenance à un Etat, et pour devenir membre à part entière d’une communauté. Il n’en reste pas moins que les droits politiques sont une prérogative des seuls ressortissants nationaux, prérogative importante, les règles d’attribution des droits sociaux et civils étant, par exemple, conçues et modifiées par ceux qui ont et qui exercent les droits politiques, à savoir les citoyens « autochtones ». Cela pose problème, surtout dans les temps de crise économique où les nationaux et leurs représentants peuvent décider de diminuer les prestations sociales accordées aux résidents étrangers, ces derniers étant exclus du processus décisionnel.
Toutefois, les résidents étrangers contribuent fortement au développement économique et social de leur pays de résidence, y paient des impôts et doivent en respecter les lois. Autrement dit, ils partagent les charges et les avantages de la coopération sociale. Leur dénier la pleine jouissance des droits politiques revient en quelque sorte à violer l’un des principes démocratiques (normatifs) fondamentaux à savoir que les personnes concernées par un ensemble d’institutions sociales et politiques devraient aussi se voir accorder des droits leur permettant d’influer sur ces institutions et leurs politiques. Reconnaissant que l’absence de ces droits politiques est une forme de déficit démocratique, certains gouvernements ont avalisé diverses modalités de participation politique, autres que le droit de vote, pour les résidents étrangers. Dans certains pays du Conseil de l'Europe, ces derniers ont la possibilité de peser indirectement sur les décisions par l'intermédiaire d’organisations financées par des fonds publics, d'organes consultatifs et de syndicats. Ainsi, l’enjeu de la pratique démocratique se déplace du niveau national au niveau local. En s’engageant dans des activités citoyennes au niveau local, les résidents étrangers entrent en contact avec des organes représentatifs, des associations et des groupes de pression qui peuvent aussi leur permettre de se faire entendre au niveau régional et national. Qui plus est, grâce à leurs activités locales, ils peuvent acquérir des compétences qui renforceront leur participation au niveau national et supranational.
L'octroi de droits politiques aux résidents étrangers, par exemple le droit d’élire un représentant aux élections municipales – comme c’est le cas en Irlande, en Suède, en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et au Luxembourg – modifie considérablement la compétition politique. En effet, les candidats qui remportent les élections doivent rendre compte de leur action à un électorat plus diversifié et répondre aux besoins d’une tranche de la population jusqu'ici exclue de la vie politique. De plus, de nouvelles questions (par exemple, dans les domaines de l’éducation et de la santé) font leur apparition ou deviennent prioritaires dans les programmes politiques.
De surcroît, donner aux résidents étrangers la possibilité de s’exprimer permet de régler les éventuels conflits ethniques et culturels par des voies démocratiques. Ainsi, les conflits, au lieu d'être occultés, sont pris à bras le corps et trouvent éventuellement une solution. Cela favorise aussi une libre confrontation des idées dans le cadre d’un dialogue ouvert, amenant la société d'accueil à s'interroger sur elle-même et à pratiquer un multiculturalisme critique.
On considère que le caractère permanent de l'installation de cette catégorie d’immigrés dans le pays d’accueil justifie un projet de citoyenneté multiculturelle où les droits politiques peuvent être partagés par les nationaux et les non-nationaux.
c) Minorités
De plus en plus, des groupes de résidents étrangers et de ressortissants d’entités infranationales revendiquent une reconnaissance collective et une participation individuelle aux processus politiques, par exemple en tant que « minorités ». Il existe des conditions favorables pour répondre à ces revendications : une population « minoritaire » importante dans certains pays, le soutien apporté par les conventions internationales à la reconnaissance des minorités, et le souci général d’assurer un accès équitable à la vie politique, sociale et économique à des groupes jusqu'ici exclus. D’un côté, la plupart des pays du Conseil de l'Europe énoncent clairement leur engagement commun à reconnaître les droits des groupes et à permettre leur exercice (par exemple dans les pays issus de l’ex-Yougoslavie). De l’autre, certains pays (comme la France) refusent de reconnaître ces groupes en tant que « minorités » et de leur accorder des droits en tant que tels, même s’ils reconnaissent l’égalité des personnes quelle que soit leur origine culturelle et ethnique. Certains pays (comme la Croatie) ont introduit des quotas dans la représentation régionale et locale pour les minorités linguistiques, alors que d’autres se sont dotés d'organes consultatifs, comme une seconde chambre au Parlement, ou de mécanismes de veto pour les communautés nationales ou religieuses. Toutefois, les membres des minorités nationales plus faibles numériquement et dispersées sur le territoire, notamment les Roms, restent exclus de la plupart de ces dispositifs.
d) Immigration clandestine
Ces dernières années, les chiffres estimatifs de l’immigration clandestine ont atteint des niveaux inquiétants, surtout dans les pays d’Europe méridionale. Les immigrés sans-papiers, qui n’ont officiellement pas le droit d'occuper un emploi, représentent une partie importante de la main-d’œuvre de l’économie « cachée » ou « souterraine » de ces pays. L’immigration clandestine est avantageuse pour les employeurs du pays d’accueil qui profitent de la plus faible rémunération des immigrés sans-papiers et de leurs horaires de travail plus longs et plus flexibles. L’Etat et le système juridique sont tous deux absents de ce secteur informel du marché. La demande de main-d’œuvre sans-papiers encourage la traite et le trafic d’êtres humains et une croissance considérable des industries parallèles qui traitent les personnes comme des marchandises. Chaque année, des milliers d'êtres humains, surtout des femmes et des enfants, sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou à d'autres fins, ce que l'on peut assimiler à une nouvelle forme d’esclavage.
Comportements à l'égard des immigrés
Selon certains observateurs, les comportements hostiles aux immigrés se multiplient de manière inquiétante dans les Etats membres du Conseil de l'Europe. La Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée a mis ce problème en relief. Des organisations internationales telles que l’Organisation internationale des migrations, l’Organisation internationale du travail et le European Centre for Racism and Immigration ont, elles aussi, attiré l’attention sur la dégradation des comportements à l’égard des immigrés extracommunautaires, que viennent renforcer les stéréotypes raciaux véhiculés par les médias et certains dirigeants politiques. D’après les données de l’Observatoire européen du racisme et de la xénophobie (EUMC), les agressions racistes ont augmenté dans la plupart des Etats membres de l’Union européenne. Pour certains pays, les statistiques officielles indiquent que le nombre des délits pourrait avoir diminué au cours des deux dernières années. Concernant les pays d’Europe centrale et orientale, Amnesty International fait état d’une augmentation des comportements xénophobes et de la violence raciste à la fin des années 1990.
Dans tous les pays du Conseil de l'Europe, les auteurs de crimes racistes sont généralement des hommes jeunes (18-26 ans) ayant un faible niveau d’instruction. Toutefois, certaines ONG ont signalé à l’EUMC qu’un nombre inquiétant d’actes de violence raciste étaient aussi commis par des policiers. Cela semble indiquer que le racisme trouve une expression même au sein des structures institutionnelles. Les partis d’extrême droite, dont les succès électoraux n'ont cessé d'augmenter à partir des années 1980, flattent souvent les sentiments xénophobes de la population dans leurs campagnes. Pour asseoir leurs stratégies électorales, ils invoquent la menace que les immigrés feraient peser sur la culture nationale et ses symboles (comme les crucifix en Italie et en Allemagne), et le lien supposé entre le chômage et le nombre d’immigrés installés dans leur pays.
Aucun élément empirique ou théorique ne permet de confirmer que l’immigration produit du chômage. Bien au contraire, certaines enquêtes montrent que les citoyens les plus susceptibles de remplacer la main-d’oeuvre immigrée ne sont pas victimes de l'augmentation de l’immigration. En outre, selon diverses études menées sur l’évolution démographique, l’immigration serait une des solutions possibles pour remédier au « déficit démographique » de l’Europe et aux problèmes qu’il entraîne. Une politique d'immigration pourrait servir les buts stratégiques économiques et sociaux qui sont les fondements de l’économie de marché de l’Europe.
Les dirigeants des partis xénophobes prétendent souvent que l’immigration représente une menace pour la stabilité politique et sociale. L'idée que la criminalité augmenterait à cause de l’immigration est aussi répandue. La peur des immigrés a été exacerbée par les événements du 11 septembre 2001 et du 11 mars 2004. Ce sont surtout les immigrés originaires des pays arabes et de l'Europe du Sud-Est qui focalisent la suspicion et la peur.
Ces représentations négatives sont souvent renforcées par l’image que les médias donnent des immigrés. Les programmes d’information, lorsqu'ils rendent compte de certains délits, en décrivent les auteurs comme appartenant à tel ou tel groupe minoritaire. Dans la même veine, les personnages de meurtriers et de délinquants de plusieurs programmes de fiction policière sont des personnes d’origine étrangère.
En même temps, les médias sont un moyen important de participation et d’intégration des résidents étrangers. Par divers mécanismes comme le financement de programmes multiculturels, certains pays ont mis en avant l’effet positif que les médias peuvent avoir sur les mentalités et les comportements de la population et sur la perception que les immigrés ont d’eux-mêmes.
Représentation
Partis politiques
Pas de démocratie sans partis politiques – même s'ils diffèrent de par leur organisation, leur idéologie, leur taille, leurs fonctions et leurs objectifs. Ils servent d’intermédiaires entre les électeurs (citoyens) et les pouvoirs publics (dirigeants). Structurant le champ politique, ils aident les électeurs à faire leur choix et les dirigeants à former des gouvernements. Les partis politiques font l’objet de nombreuses définitions qui vont de l’acception la plus large à un sens très étroit. Souvent, ces définitions se fondent sur une ou plusieurs des fonctions des partis politiques. Le critère le plus généralement admis est que les partis doivent s'affronter dans l’arène politique, s’efforcer de faire élire leurs candidats et jouer un rôle dans la formation du gouvernement. Les partis peuvent remplir un large éventail de fonctions, bien que tous ne les exercent pas dans leur intégralité, et certainement pas au même degré. Ils peuvent jouer un rôle primordial dans le recrutement et la sélection de l’élite politique en désignant des candidats aux fonctions électives et en occupant des postes au gouvernement, en formant et en soutenant des gouvernements et en élaborant des politiques. Ils peuvent aussi jouer un rôle intégrateur dans la société en mobilisant et en proposant une identité collective aux électeurs, en unissant et en articulant les groupes sociaux et en renforçant la légitimité du système politique. En outre, ils peuvent participer à la socialisation des électeurs, à la structuration du débat et/ou à la représentation sociale. Toutefois, en démocratie, un parti ne saurait représenter l’ensemble de la société comme l’illustre très bien l’étymologie du mot pars, c'est-à-dire partie). Pour éviter tout déficit démocratique, les partis, dans les systèmes démocratiques, doivent être eux-mêmes démocratiques et transparents et établir des relations solides et réglementées entre leurs dirigeants et leurs adhérents.
Membres, taille et organisation des partis
Même si les effectifs des partis ont tendance à baisser en Europe, ce phénomène touche davantage les anciennes démocraties d'Europe occidentale que les pays récemment démocratisés de l’Europe méridionale, centrale et orientale. Tous les pays d’Europe occidentale enregistrent une diminution du nombre d'adhérents de partis politiques. La situation dans les pays appartenant à la troisième vague de démocratisation est plus variable, certains connaissant même une croissance (Grèce, Hongrie, République slovaque et Espagne). Il en ressort que la diminution des effectifs des partis politiques est une tendance lourde dans les vieilles démocraties, ce qui ne laisse d'inquiéter quant à la participation des citoyens aux affaires publiques : la démocratie est en danger si l'apathie et la déception des citoyens leur font renoncer à adhérer à l’une de ses institutions essentielles. Moins ils adhèrent aux partis, moins ils votent, et moins les gouvernements seront comptables de leurs actes, moins les droits individuels pourront s'exercer et moins les revendications des individus et des groupes se feront entendre dans le processus politique. Enfin, en choisissant de ne pas être représentés dans le processus décisionnel, les citoyens accorderont d'autant moins de légitimité aux actions de leur gouvernement démocratique.
Figure 3 : Effectifs des partis en Europe occidentale et orientale
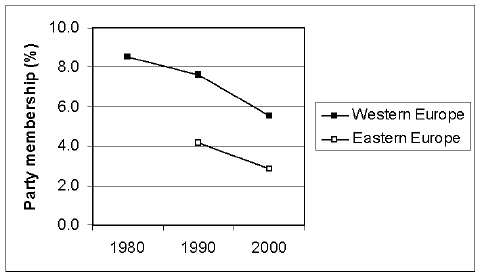
Source: Peter Mair et Ingrid van Biezen «Party membership in twenty European democracies: 1980-2000», Party Politics, vol. 7, No. 1, 2002.
La baisse du taux d'adhésion aux partis politiques n’est toutefois pas toujours inquiétante en elle-même. Elle n’est pas obligatoirement un signe de déclin de la participation politique en général : on peut, du moins en partie l'imputer à l’apparition de nouvelles formes de participation, plus attractives sur le plan individuel et plus acceptables sur le plan social (signature de pétitions, boycott de certains produits pour des raisons politiques ou manifestations pour ou contre telle ou telle mesure). En outre, l’incitation à adhérer à des partis diminue à mesure que ceux-ci se frottent à des concurrents qui semblent reprendre en partie l’une ou l’autre de leurs fonctions tout en étant moins exigeants et plus accessibles aux citoyens. De même, le changement de nature des campagnes (utilisation plus massive des médias accompagnée d’une diminution des formes traditionnelles de campagne qui font appel aux bénévoles) et la restructuration du financement des partis (le recours plus important au financement public les rend moins dépendants des cotisations des membres), font que ces derniers ont de moins en moins besoin d'avoir un grand nombre d'adhérents. Autrement dit, les partis n’ont plus à proposer un «programme régulier ou complet de manifestations où le public participe directement», hormis les événements qui sont directement liés aux élections. Enfin, un nombre élevé d'adhérents ne rend pas obligatoirement le système démocratique plus réceptif aux revendications des citoyens : plus un parti compte de membres, moins ceux-ci sont à même d'influencer la direction du parti.
Au cours des années 1990, les scandales liés au financement illégal des partis se sont multipliés dans toute l’Europe. Indépendamment du système politique ou de la structure des partis, de leur organisation ou de leur orientation idéologique, la corruption politique liée au financement des partis est devenue un problème chronique. Malgré leurs organisations institutionnelles et leurs politiques différentes, presque toutes les démocraties européennes ont eu le plus grand mal à financer convenablement leurs partis politiques et à assurer une répartition équitable de ces fonds.
Dans les années 1970, les partis s'étaient déjà dotés d'une bureaucratie permanente et importante. Ces appareils administratifs se sont avéré onéreux à entretenir, surtout pendant les années sans élections où les dons ne sont pas aussi généreux. Parallèlement, l’importance des bureaux nationaux et centraux a fini par dépasser celles des antennes locales et cela s'est accompagné d’une augmentation des besoins d’expertise professionnelle (coûteuse).
Les campagnes électorales sont devenues de plus en plus chères. Premièrement, les techniques de campagne ont changé à cause des progrès technologiques qui ont rendu le travail bénévole moins efficace. Le militantisme a perdu de l'importance et les solutions de remplacement – publicité à la télévision, à la radio et dans la presse – se sont montrées plus efficaces pour influencer le comportement de l’électorat. Deuxièmement, la nature de plus en plus compétitive et commerciale de la politique électorale et l'allongement des campagnes ont forcé les organisations centrales des partis à investir davantage d’argent et de ressources professionnelles pour obtenir le plus grand nombre de voix possibles, indépendamment des appartenances antérieures et de la solidarité de classe. Les partis ayant jugé qu’il était nécessaire de toucher un public dépassant leur base traditionnelle ont dû payer de plus en plus cher pour chaque voix supplémentaire.
En outre, en Europe, les partis avaient l'habitude et jugeaient nécessaire de maintenir, entre les élections, un niveau de participation à des assemblées politiques nationales et, parfois, régionales et locales, à des organisations sociales, à des groupes d’étude, à des fondations partisanes et à des clubs de réflexion. Or, toutes ces activités devaient être financées sur les budgets du parti (bien que parfois avec l’aide de subventions publiques). S’il est difficile de collecter des données fiables sur les montants concernés, il n’en reste pas moins qu’au cours des dernières décennies les partis des pays d’Europe occidentale, de droite et de gauche, ont commencé à soutenir des partis « frères » ou des groupes politiques dans les pays étrangers en voie de libéralisation et de démocratisation. Là encore, des fonds publics ont souvent transité par les organisations des partis ; cependant, cette activité transnationale a, sans nul doute, aussi contribué à professionnaliser le personnel permanent des partis.
Même si la législation sur les sources de financement des partis varie selon les pays européens, certaines tendances générales peuvent être observées presque partout. La composition et l'origine de leurs revenus ont changé considérablement depuis les années 1970. Les cotisations des membres sont devenues moins importantes pour leurs budgets. En effet, la baisse de leurs effectifs les a empêchés de réunir suffisamment de fonds à partir de cette source. Ensuite, l’énorme inflation de leurs besoins de financement les a obligé à s’adresser ailleurs pour obtenir un soutien financier. Enfin, dans les nouvelles démocraties de l’Europe méridionale et orientale, les cotisations des membres n’ont jamais eu une importance primordiale, d'une part en raison du contexte historique des régimes à parti unique, avec leurs diverses formes de contributions obligatoires, et, d'autre part, à cause du rythme du changement de régime.
Les partis puisent à une autre source importante de revenus : les dons. Ces derniers peuvent être d'origines diverses : particuliers, entreprises, syndicats et/ou associations de la société civile. Certains dons privés ont été interdits ou limités par la loi, mais il n’a pas été difficile de trouver des subterfuges. Dans la plupart des pays européens, les dons de gouvernements, de partis, d'entreprises ou de particuliers étrangers sont interdits, mais des sommes dont on ignore le montant semblent encore réussir à contourner cette interdiction, notamment par le biais de « pots de vin » provenant de contrats d’aide étrangère et d'entreprises publiques travaillant à l’étranger. Il va sans dire que nombre des scandales liés au financement des partis qui ont éclaté ces dernières années ont leur origine dans le monde, trouble et difficile à contrôler, des dons.
Traditionnellement, les partis obtenaient des fonds de toute une variété d’entreprises leur appartenant ou étroitement liées à eux : imprimeries, journaux, éditeurs, agences de voyage, consultants, bureaux d’urbanisme, instituts de recherche, sociétés de loisirs, clubs de sport et, plus récemment, fondations. S’il est difficile d'apprécier l’évolution de l’importance de ces sources de financement, il semble qu’elles aient diminué soit en raison de la moindre solidarité idéologique, soit à cause de la concurrence commerciale. Par exemple, il est douteux qu'en Europe, un journal ou une maison d’édition fasse actuellement des bénéfices assez considérables pour être une source importante de financement de tel ou tel parti.
Les subventions publiques aux partis ont beaucoup augmenté depuis les années 1970. Si ces aides étaient rares il y a trente ans, elles représentent aujourd’hui une source majeure de revenus pour les partis dans toute l’Europe. La législation de chaque pays détermine la répartition de ces subventions, la manière dont elles peuvent être dépensées et comment elles doivent être contrôlées. Elles peuvent être allouées directement sous la forme de fonds, ou indirectement sous la forme d’un accès gratuit à la télévision ou à d’autres médias, ou encore sous les deux formes à la fois.
b) Corruption
Le financement illégal des partis est un phénomène qui frappe depuis longtemps toutes les démocraties européennes. Or, ce n’est que récemment qu’il semble être devenu une menace pour leur légitimité et une cause de perte de confiance de l’opinion publique. C'est la législation nationale qui définit ce qui est illégal ; ce qui est illégal dans un pays peut être légal dans un autre. Des revenus peuvent être illégaux s’ils proviennent de sources dont la contribution est interdite par la loi (comme les entreprises ou les gouvernements étrangers), de la criminalité organisée, de contributions individuelles dépassant les limites légales ou contournant les conditions légales de comptabilisation. Citons parmi les sources illégales, bien que consacrées par l’usage, les dessous de table versés dans le cadre des contrats publics, et les pots-de-vin donnés habituellement au parti au pouvoir en échange d’un traitement favorable.
On ne dispose d’aucun moyen fiable et objectif d’évaluer si, sur les trente dernières années, les partis sont devenus plus ou moins corrompus. L’écart entre une demande de financement croissante et une offre limitée en provenance des sources traditionnelles laisse penser que l’incitation matérielle à recourir à des moyens de financement inavouables est plus grande que par le passé. Il semble clair, en revanche, que l’opinion publique est devenue moins tolérante à l'égard du financement illégal, même s’il n’est pas entaché d’escroquerie ou de profit personnel. Les citoyens semblent appliquer des critères plus stricts de moralité à leurs représentants et dirigeants ; ils sont aussi mieux informés sur les pratiques de corruption grâce à Internet et aux indicateurs comparatifs comme ceux établis par Transparency International. Les médias ont pris l’habitude de rendre publics les scandales liés au financement. Le pouvoir judiciaire est plus disposé à poursuivre ceux qui commettent ces actes, et les citoyens plus enclins à réagir en sanctionnant même ceux qui ne sont que soupçonnés de corruption. Indépendamment des répercussions à long terme pour la démocratie, les conséquences à court terme sont préoccupantes. Les régimes européens actuels ont un grave problème avec leur « économie politique interne ». La démocratie coûte cher, et de plus en plus cher à chaque enjeu électoral. Ses bénéficiaires ultimes, les citoyens, sont moins disposés à en payer le coût, que ce soit par des contributions privées volontaires ou des subventions publiques obligatoires. Si les partis, qui sont encore le seul moyen connu de structurer la compétition électorale et la formation des gouvernements, faisaient faillite et disparaissaient, la démocratie telle que nous la connaissons disparaîtrait avec eux.
c) Les partis s'éloignent de la société civile et se rapprochent de l'Etat
Ce phénomène est dû à de nombreux facteurs, dont la baisse du taux d’adhésion aux partis, la transformation des techniques de campagne et la dépendance des partis vis-à-vis de l’Etat pour le financement de dépenses en augmentation. Le travail des bénévoles est devenu dépassé à partir du moment où les partis ont privilégié la télévision pour tenter d'atteindre la population. En outre, les dons de particuliers, forme passive de participation, ont diminué. Un grand nombre de petites contributions ont été progressivement remplacées par un petit nombre de dons importants. Dans le même temps, les partis sont devenus de plus en plus financièrement dépendants des fonds publics et, dans certains cas, des grandes entreprises. Le rôle de l’Etat est fondamental, non seulement parce qu'en Europe, il est devenu le principal bailleur de fonds des partis, mais aussi parce que le parti au pouvoir ou les partis qui le contrôlent peuvent avoir accès à d'autres sources (souvent illégales) de revenus. D'un côté, les avantages d'être au pouvoir ont augmenté et, avec eux, le risque d'oligarchie. De l’autre, tous les partis, sous-financés, risquent de perdre de l’importance et de se fragmenter si aucun d'entre eux ne réussit à établir de lien avec son public cible.
d) Désaffection et apathie des citoyens à l'égard de la politique
Le problème n'est pas seulement le déclin de la participation à la vie des partis (d'autres formes de participation politique peuvent la remplacer) ou la diminution des dons privés (d'autres sources, surtout publiques, se sont développées). Le pessimisme quant à la motivation et aux pratiques des responsables politiques s’est tellement accentué qu'une grande partie de la population considère la corruption politique comme le cours normal des choses.
* * *
Ces problèmes ne sont que partiellement inhérents aux démocraties « réelles ». Ils sont aussi étroitement liés aux défis et perspectives exogènes décrits dans le chapitre I.
La mondialisation et ses conséquences sont l'un des défis majeurs qui se posent aux partis politiques en Europe. Tout d'abord, la libéralisation du commerce suppose que l'argent se déplace de plus en plus librement à travers les frontières nationales, ce qui élargit l'éventail des sources potentielles de soutien financier des partis et s’est montré fort utile pour l'opposition dans les pays post-communistes luttant pour la démocratie en Europe centrale et orientale et dans l'ex-Union soviétique. Elle place aussi devant un dilemme les démocraties nationales bien implantées qui tentent de résister à l'afflux de fonds étrangers dans leurs élections et leurs processus politiques nationaux. En deuxième lieu, la concentration de l'argent que la mondialisation met dans les mains d’entreprises multinationales et de riches particuliers pourrait permettre aux partis de réunir plus facilement des fonds. Toutefois, ces partis seraient alors plus vulnérables à l'accusation d’être devenus trop dépendants des milieux d’affaires. Dans la mesure où ce phénomène traverse les clivages politiques, il renforce l’idée populaire que « tous les partis sont pareils » et qu’il est inutile de choisir entre eux.
L'intégration européenne pose un défi très semblable. La tendance à intégrer les marchés, les professions et les politiques à une échelle régionale contredit de manière flagrante l’un des postulats fondamentaux du système des partis, à savoir qu'ils sont responsables de l'organisation de la compétition politique sur la base d'une entité territoriale souveraine, l'Etat national. Par exemple, les personnes travaillant et vivant dans un pays dont ils ne sont pas des ressortissants, n’ont généralement pas le droit d'aider financièrement les partis de l'Etat où ils résident. En revanche, les entreprises légalement constituées dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne, mais à capital étranger, sont libres de faire des dons à des partis.
Les mutations technologiques ont littéralement révolutionné les campagnes politiques et, dans certains pays, commencent à peser sur la collecte des fonds. La télévision s'est solidement établie comme le média essentiel pour toucher le grand public pendant les élections. Selon le panachage des chaînes privées et publiques et le contenu des contrats de licence, le coût financier des campagnes a considérablement augmenté, entraînant une dépréciation du travail bénévole des membres des partis. Cela a aussi privilégié la personnalité des candidats aux dépens de leurs programmes politiques, car c'est ce que véhicule le mieux cette forme de communication de masse où le temps joue un rôle capital.
Il est trop tôt pour savoir si les technologies de l'information et de la communication, et en particulier Internet, entraîneront une révolution analogue. Internet semble avoir le potentiel d'inverser la tendance à l'explosion des coûts et donc d’équilibrer les conditions de la compétition entre les partis, grands et petits, bien et mal dotés. Tout incite à penser que les partis expérimentent massivement ce support pour toucher leurs membres, leurs donateurs potentiels et leurs électeurs éventuels. Aujourd'hui, aucun parti ne peut se permettre de ne pas avoir de site Web. C'est aussi le cas des candidats et des élus. Cette forme de communication directe qui se généralise rapidement (et, par la suite, le vote électronique) aura-t-elle comme effet d'ébranler encore plus les formes traditionnelles d'organisation et d'affiliation des partis ?
Le sentiment d'insécurité a probablement un effet important mais indirect sur l'organisation et l'activité des partis. Comme nous l'avons vu précédemment, l’accroissement de la demande de fonds (et la diminution de l'offre par les membres) rend les partis vulnérables aux pratiques de corruption. L'influence de la criminalité organisée comme source potentielle pour combler ce déficit s’en voit donc renforcée. D'ailleurs, certaines techniques de financement illégal des partis ressemblent beaucoup à celles du blanchiment de l'argent, et certains moyens employés pour solliciter des contributions ne sont guère différents du racket ou de l'extorsion de fonds. Si tous les partis ou une grande partie d’entre eux ont recours à cette source de financement clandestin, cela renforcera la tendance déjà existante à condamner les partis comme étant intrinsèquement corrompus et incapables de lutter contre la criminalité organisée.
Nul ne peut juger avec exactitude dans quelle mesure les causes extérieures d'insécurité, les Etats hostiles et les acteurs non étatiques menaçants, influent sur le comportement et le statut des partis politiques en Europe. Il n’y a pas si longtemps les « contributions » clandestines de l'Union soviétique étaient exploitées pour discréditer les partis communistes nationaux, comme cela s'était passé dans l'entre-deux guerres avec les « transferts » fascistes et national-socialistes à travers les frontières. A l'époque contemporaine, le financement transnational des organisations partisanes et de celles de la société civile dans les pays en voie de démocratisation, est devenu une pratique ouvertement reconnue qui ne semble pas avoir jeté le discrédit sur ses bénéficiaires. L'argent circulant dans la direction opposée, à savoir de gouvernements autocratiques vers des partis de régimes démocratiques, est une tout autre question. La « guerre contre le terrorisme » et « la guerre contre la drogue » ont attiré l'attention sur le trafic international de fonds clandestins mais, jusqu'à présent, les partis politiques européens n'ont pas été éclaboussés par des révélations gênantes.
Un système de partis européens, une digression
Les partis politiques européens pourraient apporter une réponse à la perte d'autonomie de l'Etat national et à la diminution parallèle des effectifs des partis politiques. Le développement d'un authentique système de partis dans les Etats membres de l'Union européenne représenterait un pas en avant important, vers la création d’un demos européen, avec sa communauté de citoyens et son électorat propres. Ces partis ne remplaceraient certainement pas, dans un avenir prévisible, les partis nationaux traditionnels, compte tenu de l'asymétrie qui persiste entre l'importance et les fonctions des parlements nationaux et ceux du Parlement européen, sans oublier les difficultés intrinsèques que pose la création d'identités partisanes à une si grande échelle pour une population aussi hétérogène sur le plan linguistique et culturel.
Le déplacement des compétences économiques et politiques du niveau national au niveau européen, n'a pas encore été accompagné par un déplacement équivalent en matière de légitimité démocratique. Les institutions communautaires n'ont pas la légitimité de leurs homologues nationaux et le fossé entre les citoyens européens et les institutions européennes semble se creuser. Selon les enquêtes d'opinion, de nombreuses personnes considèrent que les institutions de l'Union sont lointaines, bureaucratiques et non démocratiques. Ce déficit démocratique est aggravé par les responsables politiques nationaux qui ont tendance à utiliser l'Union européenne comme bouc émissaire et qui se gardent d’expliquer leur propre rôle dans l‘adoption de la législation européenne. D’où l'absence d'un demos européen, bien illustrée par l’écart important entre la participation aux élections nationales et aux élections du Parlement européen.
Pour qu’un demos européen puisse exister, il faudrait d’abord que l’on accorde plus d'importance aux questions politiques européennes (par opposition aux questions nationales). Prise en sandwich par la distinction traditionnelle entre politique intérieure et étrangère, l'importance de cette nouvelle dimension régionale n'a pas été assez bien expliquée à ceux qu'elle concerne. Les Européens, s'ils savaient combien de questions, qui relevaient jusqu’ici de la politique nationale, sont passées au niveau régional, pourraient être mieux disposés à s'allier par delà les frontières nationales pour créer et financer des partis politiques authentiquement transnationaux. Dans l'état actuel des choses, ils sont vaguement conscients que leurs intérêts sont structurés, dans les élections européennes et au sein du Parlement européen, par des « fédérations » de partis nationaux qui n'ont pas de programme commun. Cela ne fait qu’agréger et reproduire de manière superficielle les différents clivages apparus historiquement au sein de chaque Etat membre, plutôt que de reconnaître et refléter les clivages qui transcendent les frontières nationales.
L'absence d’authentiques partis européens s'explique par l’organisation des élections du Parlement européen. En effet, celles-ci ne sont pas organisées de la même manière dans tous les Etats membres. Si, lors des dernières élections, tous les pays ont utilisé en gros le même système de représentation proportionnelle, les règles d'attribution des sièges et de découpage des circonscriptions sont encore très différentes. Les élections n'ont pas lieu le même jour et, dans certains cas, elles coïncident avec des élections locales, municipales ou provinciales. Avec, comme conséquence, ce qu'on a appelé des « élections de second ordre » dont le but apparent est de choisir des élus au Parlement européen où ils devront s'occuper de questions européennes mais qui, dans la réalité, se feront l'écho des questions « nationales ». Les eurocitoyens en sont bien sûr conscients et utilisent ces élections avant tout pour envoyer un message à leurs dirigeants nationaux, souvent de mécontentement parce qu'ils peuvent se permettre de voter pour des candidats et des partis plus extrémistes en sachant qu'ils ne seront pas gouvernés par ceux-ci. La conséquence fâcheuse est que des gouvernements en place et des partis d'opposition centristes obtiennent de mauvais résultats qui peuvent avoir des répercussions graves pour la stabilité de la politique intérieure. Autre aspect de plus en plus inquiétant des élections européennes : elles sont caractérisées par un taux de participation beaucoup plus faible de l'électorat qu'aux élections nationales. Les élections tenues successivement depuis 1979 ont attiré à chaque fois une moindre proportion d'électeurs. Cela a été le cas dans pratiquement tous les Etats membres, bien que les pouvoirs effectifs du Parlement européen aient manifestement augmenté au cours de la même période.
Les groupes politiques au sein du Parlement européen ne fonctionnent pas et ne peuvent fonctionner comme des partis européens. Non seulement leur composition est hétérogène – certains partis peuvent avoir une composition sociale et un programme très différents selon les Etats membres, même s'ils sont rassemblés sous la même étiquette – mais ils n'ont en outre aucune véritable infrastructure organisationnelle. Par exemple, ils ne jouent pratiquement aucun rôle dans le choix des candidats pour les élections au Parlement européen. Leur financement est depuis longtemps bien mystérieux, par manque de transparence et de contrôle. Leurs dépenses sont laissées exclusivement aux soins des partis nationaux qui reçoivent des subventions directement du Parlement européen pour couvrir les coûts des campagnes. Ces partis n'ont pratiquement aucune raison de privilégier des questions franchement européennes et, répétons-le, ils polarisent leurs campagnes sur les questions nationales.
Société civile
Pratiquement tous ceux qui étudient la démocratie contemporaine reconnaissent que l’existence d'une société civile viable et vivante, faisant pression sur les autorités pour attirer leur attention sur ses droits, ses intérêts et ses causes, contribue positivement à la longévité et à la qualité de la démocratie moderne, et cela pas uniquement en Europe et aux Etats-Unis. Notons que la société civile contribue à ce résultat, mais qu'elle n'en est pas la cause. Elle ne peut engendrer à elle seule la démocratie. Pas plus qu'elle ne peut à elle seule soutenir et améliorer les processus démocratiques une fois qu'ils sont en place. Comme nous le verrons, la société civile agit de pair avec d'autres institutions et pratiques – la participation des particuliers, la compétition entre les partis politiques, le processus législatif, des élections régulières et équitables pour les principales fonctions, l'équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants, une presse libre et diversifiée, des pouvoirs locaux et provinciaux autonomes, la primauté du droit et un pouvoir judiciaire indépendant, pour ne nommer que les plus évidents.
Avant de procéder à une analyse de l'état actuel de la société civile en Europe, commençons d'abord par la définir. La société civile est un ensemble ou un système de groupes intermédiaires auto-organisés qui : 1. sont relativement indépendants des pouvoirs publics et des unités privées de production et de reproduction, c'est-à-dire des entreprises et des familles ; 2. sont capables de débattre et de mener des actions collectives pour défendre ou promouvoir leurs intérêts ou leurs idéaux ; 3. ne cherchent cependant pas à remplacer l’Etat ni les unités de (re)production privées, ni à assumer la responsabilité de diriger l'ensemble du système politique ; 4. acceptent toutefois d'agir dans le cadre des règles préexistantes de nature « civile », publiques et fondées sur le respect mutuel.
Les groupes multiples et variés de la société civile peuvent s’imposer des limites en s’efforçant d’influencer les élus sans chercher à les remplacer et en acceptant de se respecter les uns les autres. Mais leur présence dans la vie politique n'est pas toujours un avantage. En d'autres termes, la simple présence d'un tel mélange d'associations défendant leurs intérêts et de mouvements sociaux tournés vers les autres peut produire à la fois du bon et du mauvais pour la collectivité. L'expérience européenne (et américaine) sur le long terme indique toutefois que les effets bénéfiques de la société civile l'emportent de beaucoup sur ses effets nocifs. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, compte tenu des défis et des perspectives auxquels font face les sociétés contemporaines d'Europe occidentale et orientale, la balance penchera du bon côté.
L'obstacle le plus évident pour évaluer l’évolution du rôle de la société civile est la nature toujours changeante du sujet lui-même. Comparés à l'abstention électorale, à la confiance de l'opinion publique dans les institutions, aux changements de majorité ou à l'augmentation du nombre de référendums, lorsqu'il s'agit de la société civile, les groupes d'intérêt, les mouvements sociaux et les fondations caritatives qui la composent sont beaucoup plus fluctuants, tant dans la forme que dans la fonction. A l'exception des organisations où l'adhésion est obligatoire et dont le champ d’activité est fixé par le droit public, par exemple les « ordres » professionnels, les « chambres » sectorielles et certaines associations commerciales et syndicales, la plupart des composantes de la société civile sont libres de choisir qui elles souhaitent représenter et comment elles interprètent leur mission. En conséquence, leurs ressources matérielles et leur statut organisationnel sont continuellement à la merci de changements dans la structure sociale, les préférences des consommateurs et les objectifs politiques. Des formes d'association qui ont joué un rôle important, voire crucial, dans la vie politique, peuvent progressivement décliner, pour être remplacées, si tout va bien, par d'autres formes d'action collective autonome. Par exemple, un chercheur américain en sciences sociales a tiré des conclusions extraordinairement négatives - « il y a toutes les raisons de penser que certaines des conditions sociales et culturelles fondamentales d’une démocratie efficace se sont érodées au cours des dernières décennies » (Putnam and Goss, 2002, page 3) - de la tendance de ses concitoyens à jouer cavalier seul, tout en ignorant leur propension à rechercher d'autres moyens de se rencontrer et d'exprimer politiquement leurs intérêts et idéaux communs.
Figure 4 : Taux de syndicalisation en Europe (% de la population économiquement active), moyenne mobile

Source : Eurobaromètre et World Value Survey (1995-97)
Prenons d’abord le cas des syndicats. Il ne fait aucun doute que cette forme d’action collective a influé fortement et durablement sur la démocratisation des systèmes politiques européens et sur leur action politique au quotidien. Les syndicats ont lutté pour les droits de leurs membres et des travailleurs en général, qu’ils ont mobilisés périodiquement pour assurer une répartition plus équitable des bénéfices des politiques publiques entre les citoyens. Aucune histoire nationale de la société civile ne saurait les ignorer, ni ignorer l'influence démocratique qu’ils ont eue sur les partis politiques, les groupes d’intérêt et les mouvements sociaux.
La figure 4 montre l’évolution sur le long terme du taux de syndicalisation en pourcentage de la population économiquement active en Europe depuis 1972. Toutes les observations ont été « lissées » en utilisant des moyennes mobiles sur trois ans et « normalisées » pour refléter les différences de taille entre les pays et l’évolution de la composition du Conseil de l'Europe. Selon les deux projections alternatives (l’une linéaire, l’autre pondérée dans le temps), le taux de syndicalisation (qui était de 28 % dans la période 2001-2004) sera d'environ 25 % en 2010-2012 et 22 % en 2018-2020, à condition que les tendances socio-économiques lourdes persistent et qu’aucun changement important n'intervienne dans les politiques publiques. Si nous ne tenons compte que des pays pour lesquels nous disposons de données et qui étaient membres du Conseil de l'Europe au début des années 70, la situation ne change pas beaucoup. La tendance est encore relativement stable et l’on prévoit que le taux en 2018-2020 sera plutôt de 23 % de la population économiquement active que de 22 %. Nous ne disposons pas de données comparables pour les syndicats en Europe centrale et orientale et dans les républiques de l’ex-Union soviétique, mais celles qui existent laissent penser que le taux de syndicalisation évolue conformément aux tendances indiquées, bien qu'il se situe plutôt vers le bas de la fourchette.
Contrairement aux prédictions alarmistes anticipant la disparition d’une classe ouvrière organisée (ou son asphyxie par les travailleurs non syndiqués de l’Est), notre conclusion est plus rassurante, surtout lorsqu’on prend en considération les changements intervenus dans la composition sectorielle de l’emploi (le déclin relatif de la production industrielle où la syndicalisation était traditionnellement plus forte), le recentrage du rapport entre hommes et femmes dans la main d’œuvre active (ceux-là étaient plus faciles à recruter que celles-ci) et la part croissante du travail à temps partiel (idem). Par exemple, le taux de syndicalisation aux Etats-Unis a chuté beaucoup plus fortement, passant de 45 % en 1970 à 18 % en 1995. Force est néanmoins de conclure que l’une des catégories les plus importantes et les plus stables d’association au sein des sociétés civiles européennes perdra en importance relative, même s'il est certain qu'elle ne « s'éteindra » pas.
La figure 4 fait aussi apparaître une deuxième tendance. Au début de la série chronologique (environ 1972), l'écart entre les taux de syndicalisation nationaux compris entre 68 % et 20 % était de 48 points. Grâce à l’entrée des pays d’Europe méridionale au Conseil de l'Europe, cet écart s’est considérablement creusé. En effet, le pays le plus syndicalisé avait un taux de 87 % en 2003, et le moins syndicalisé un taux de 10 %, soit une différence de 77 points. On ne sait pas encore avec certitude s’il s’agit d’une « divergence » temporaire due au caractère récent de la démocratisation et à la diffusion soudaine des libertés d’association, de réunion, d'expression et de recours après une longue période de répression par un régime à parti unique, ou d'une tendance plus profonde à l'individualisme, voire à une hostilité - dans les néodémocraties - aux formes d’action collective fondées sur les intérêts de classe et les intérêts catégoriels. Il est clair, en revanche, que si le Conseil de l'Europe devait avoir comme politique déclarée de promouvoir une plus grande convergence des qualités des sociétés civiles de ses Etats membres et si cette convergence devait viser un plus haut degré de performance, il faudrait s'engager dans des réformes très ambitieuses.
Une troisième tendance observée chez les syndicats – plus difficile à documenter – semble être la diminution de leur nombre à tous les niveaux de regroupement (en grande partie, par suite de fusions) et l'augmentation de la proportion d'associations spécialisées membres de fédérations et de confédérations qui les chapeautent. En bref, le mouvement syndical semble traverser un processus de consolidation organisationnelle, avec une évolution vers des unités de base comptant un plus grand nombre de membres et ayant un champ de représentation plus étendu.
Figure 5 : Taux d'adhésion aux associations bénévoles in Europe, moyenne mobile (en %)
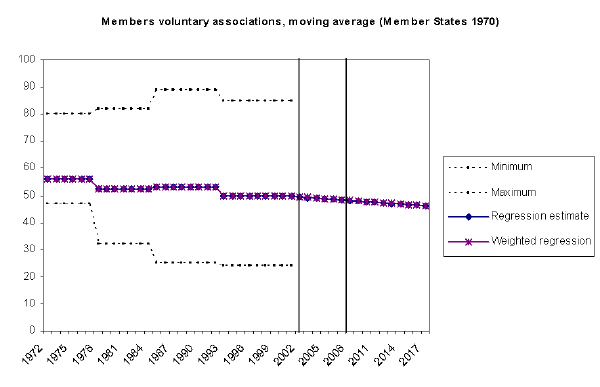
Source: Eurobaromètre et World Value Survey (1995-97)
Nous avons jusqu’à présent fait l’erreur de supposer que l’évolution des effectifs et de la structure organisationnelle d'un type particulier d’association était en quelque sorte emblématique de l’ensemble de la société civile. S’il est vrai que les syndicats ont joué historiquement un rôle beaucoup plus important pour la démocratie que, par exemple, les associations de pétanque, il n’en reste pas moins qu’il est parfaitement plausible que d’autres types d’associations aient suivi des modèles différents. Or, nous allons maintenant commettre l’erreur inverse, à savoir de supposer que la composition des associations bénévoles a partout la même signification. Grâce aux enquêtes régulières effectuées par Eurobaromètre depuis 1977 et par World Value Survey en 1995-1997, nous disposons de données sur la proportion de personnes déclarant appartenir à au moins une association dans un échantillon aléatoire de la population de vingt-huit pays. Elles figurent dans la figure 5 ci-dessus, selon des moyennes mobiles sur trois ans commençant en 1975. Les deux points d’infléchissement (1975-1977 et 1995-1997) correspondent ici encore aux grands changements intervenus dans la composition du Conseil de l'Europe (extension vers le Sud, puis vers l’Est) et, dans les deux cas, ils font apparaître une réduction de la proportion des personnes déclarant appartenir à une association. Pour l’ensemble de l’Europe, cette proportion, (pondérée par la taille des pays) est de 47 % et les projections linéaires et pondérées par le temps seraient, en 2010, de 48 % (linéaire) et de 46 % (pondéré) et, en 2020, de 48 % (linéaire) et de 45 % (pondéré) – ceteris paribus. Si l’on n'inclut que les pays déjà membres du Conseil en 1972, les chiffres correspondant sont de 50 % (2003), de 55 % (2010) et de 57 % (2020). L’écart entre le meilleur et le plus mauvais chiffre était de 47 points en 1975 et, étonnamment, de 72 points en 2003, si l'on inclut tous les pays, et de 46 points en 1975 et de 61 points en 2003 si l'on ne prend en compte que les dix-huit premiers Etats membres.
Les faits sont, cette fois, moins préoccupants. La démocratisation, au Sud et à l’Est, semble avoir eu un effet réducteur sur « la sociabilité primaire » en Europe, mais l’impression globale est celle d’une stabilité exceptionnelle. Si rien ne change, les Européens de l’Ouest qui sont membres d’au moins une association seront même marginalement plus nombreux en 2020 qu’en 2003. Leurs frères et sœurs de l’Est sont peut-être moins « associatifs », mais leur effet net ne fera diminuer le total que de 2 ou 3 points de pourcentage.
Examinons une nouvelle fois ce même ensemble de données en choisissant et en distinguant grosso modo deux types d’organisations : premièrement, celles qui proposent directement des services et des avantages à leurs membres (sociales) ; et, deuxièmement, celles qui sont plus enclines à présenter aux autorités des revendications qui bénéficient indirectement à leurs membres et l'ensemble de la population (politiques). Dans la première catégorie se trouvent des groupes assurant des services sociaux et s'occupant de santé personnelle, d’éducation, d’art, de musique, d’activités culturelles, de jeunesse, de sports, de loisirs et de divertissements. La deuxième catégorie regroupe les syndicats, les associations professionnelles, les groupes locaux, les partis politiques, les mouvements de défense des droits de l'homme, de la paix, du développement du tiers-monde, de la préservation des ressources, de la protection de l’environnement, de l’égalité des sexes, et ainsi de suite. Au début de notre série chronologique (1974), les organisations ostensiblement politiques étaient proportionnellement un peu plus importantes (55 % de la population européenne ayant déclaré appartenir à au moins l’une d’entre elles) que les organisations sociales (51,2 %). Nos dernières observations (2003) montrent que les premières ont diminué beaucoup plus rapidement (jusqu’à 33,2 %) que les secondes (39,5 %). Selon nos projections, seuls 22,8 % des Européens, en 2010, et 13,7 %, en 2020, seront membres d’une association ou d'un mouvement politique – ici encore ceteris paribus. Il est vrai que les choses peuvent beaucoup changer pendant cette période. Nous avons des raisons de penser que la participation à ces organisations a nettement augmenté pendant les années 1950 et 1960, ce qui donne à entendre qu’un processus cyclique pourrait être à l'œuvre au sein de la société civile. Mais qu’est-ce qui pourrait enclencher un tel retournement de situation à l’avenir ? Notre analyse n’a pas réussi à détecter de processus « naturel » extérieur à la démocratie qui pourrait être ce déclencheur. Seules des réformes conscientes et conséquentes des règles et pratiques internes peuvent apporter l'encouragement nécessaire.
Il y a une grande différence entre se déclarer prêt à travailler bénévolement dans une association et y adhérer. Il se pourrait donc que les partis, associations et mouvements comptent moins d'adhérents, mais qu’un plus grand nombre de personnes y travaillent. Les données sur ce « bénévolat » sont sporadiques et soumises à de grandes variations à cause de changements apparemment mineurs dans le libellé des questions de l’enquête. Elles font toutefois apparaître une augmentation progressive dans la plupart des pays d’Europe occidentale entre 1981 et 1999. Nous ne disposons pas de données comparables pour l’Europe orientale, même sur une période plus courte. Toutefois, il ne serait pas surprenant que les niveaux soient beaucoup plus bas, étant donné les bouleversements qui ont accompagné les changements de régime dans cette partie du monde.
Nous arrivons à présent à un paradoxe intéressant. Bien que les données soient dispersées et difficiles à interpréter comparativement, elles n’indiquent aucune tendance à la diminution du nombre total d’associations, de mouvements, de sociétés et de fondations. La baisse de la proportion de la population affirmant être membre d’au moins une association ne semble pas décourager les « créateurs d'organisations » d’essayer de fonder de nouvelles unités de la société civile. S’il est vrai que nous ne disposons pas d’informations fiables sur les organisations qui échouent et disparaissent, l’impression qui se dégage clairement est celle d’une croissance nette dans pratiquement toutes les sociétés européennes. On peut en conclure que l’univers devient de plus en plus spécialisé. De plus en plus d'associations, de mouvements et de fondations sont en quête d'adhérents et de fonds pour défendre des conceptions de plus en plus sui generis des intérêts et idéaux collectifs.
Or, comme nous l’avons fait observer précédemment pour les syndicats, il y a des raisons de penser que les organisations « traditionnelles » représentant les intérêts de classes sociales, de secteurs économiques et de professions spécialisées, tendent à fusionner et donc à diminuer en nombre. C’est pourquoi le dynamisme ne peut que venir des entrepreneurs défendant de nouveaux intérêts et idéaux qui, selon nous sont pour la plupart, de l’ordre des loisirs, de la culture, de l’éducation et des services sociaux, mais comprennent aussi une grande variété de « causes » : environnement, droits de l'homme et des animaux, féminisme, antimondialisation et démocratie. Il est difficile d'apporter la preuve de cette réorientation vers de « nouveaux mouvements sociaux » car leur nature même empêche souvent de compter avec précision leur nombre et leurs membres. Néanmoins, le développement des actions collectives « non conventionnelles » dues à ces mouvements – protestations, pétitions, boycotts et manifestations – est devenu évident et transcende les frontières des systèmes politiques nationaux. La relation de ces activités avec des formes plus traditionnelles de participation démocratique - vote, identification à un parti, appartenance à un syndicat ou à des associations civiques – est moins évidente. On ignore également si les jeunes qui forment l’essentiel des participants à ces formes d’organisation en réseau finiront par se stabiliser et adhérer aux mêmes partis et associations que leurs parents.
Analyse
Comme sa variabilité intrinsèque et son adaptabilité constante pouvaient le laisser penser, la société civile a été probablement plus touchée que tout autre dimension de la démocratie par les défis et perspectives exceptionnels présentés au chapitre I. Chacun d’entre eux semble avoir eu un effet sur les associations, leur composition, leur nombre, leur champ d’action ou leurs ressources.
Mondialisation. Dans ce domaine, la grande différence a été la multiplication des organisations non gouvernementales transnationales, en particulier celles qui défendent toutes sortes de causes allant de la démocratie et des droits de l'homme à l’environnement et à l’égalité des sexes. L’effet a été particulièrement marqué dans les nouvelles démocraties d'Europe orientale où la disproportion entre les ressources financières et les intérêts défendus était plus importante. Dans les démocraties occidentales mieux assises, ces ONG se sont principalement intéressées à la mondialisation et à ses répercussions économiques, sociales et environnementales sur une communauté de citoyens de plus en plus instruits et sensibles aux dilemmes de « l’interdépendance complexe ». Il n’est guère de gouvernement en Europe qui n’ait eu à faire face à la pression d’organisations dont les ressources humaines et matérielles viennent de l'étranger et dont les réseaux d’influence pénètrent profondément dans ce qui était jusqu'ici le pré carré de la politique nationale. Il reste à savoir si ce phénomène réduit l’éventail des réponses politiques ou élargit les ressources potentielles pouvant être mobilisées pour s’attaquer à ces questions complexes. Quoi qu'il en soit, l'issue pèsera fortement sur l’efficacité et la légitimité des dirigeants nationaux et supranationaux.
Intégration européenne. Les directives et la réglementation de l’Union européenne ont eu des répercussions sur les sociétés civiles des Etats membres, candidats et limitrophes, et même contribué la formation d’un embryon de société civile européenne. Dans ce domaine aussi, l’impact plus fort a été ressenti par les néo-démocraties de l’Est, et surtout par celles qui s'évertuent à respecter les obligations de l’acquis communautaire et se disputent les fonds des différents programmes de l’Union européenne. Dans quelques domaines comme l’agriculture et les fonds régionaux, il est désormais impératif d'exercer une influence au niveau européen, alors que, dans la plupart des cas, les associations et les mouvements ont l’habitude d’agir par l’intermédiaire de leurs autorités nationales respectives. Les politiques de l’Union européenne ont aussi ouvert des possibilités exceptionnelles d'accéder directement aux grandes entreprises transnationales. Le bilan est donc mitigé. Pluralisme, d’une part, pour les groupes d'intérêt fonctionnels spécialisés et un certain nombre de causes, grâce à la prolifération des points d’accès à ce nouveau système politique à « plusieurs niveaux » et « multicentrique ». Corporatisme, d’autre part, pour ceux qui, au niveau supranational et national, bénéficient de ressources privilégiées ou d'un accès spécial à certains organismes. Il est particulièrement frappant de constater que des systèmes nationaux de concertation politique ont fait leur réapparition pour répondre au double défi du marché unique européen et de l’unification monétaire.
Immigration et coexistence interculturelle. Un des principaux problèmes auxquels les sociétés civiles européennes ont dû faire face est celui du nombre croissant de migrants, de demandeurs d’asiles et de réfugiés venant de pays extra-européens. Dans le passé, ces « étrangers » étaient d'abord assimilés dans les cultures nationales, puis adhéraient aux syndicats, associations professionnelles et autres organisations intermédiaires existants. Lorsqu’ils formaient leurs propres associations et mouvements, on supposait généralement qu’il s’agissait simplement d’une étape de leur parcours vers l'intégration finale. La situation contemporaine se distingue en ce que de nombreux résidents étrangers insistent sur leur droit à rester différents et à créer leur propre société civile. Ils réclament non seulement que leurs organisations soient reconnues, mais qu’elles soient entendues et puissent exercer une influence. Cette évolution est d'autant plus controversée que les étrangers viennent souvent de pays qui connaissent de profondes divisions internes et parfois une violence endémique. L’une des choses les plus difficiles à prédire dans l’Europe contemporaine est de savoir si ces revendications du droit à une différence perpétuelle provoqueront une réaction hostile et « incivile » dans les partis, associations et mouvements des autochtones ou si elles contribueront à une diversification pluraliste des modèles de compétition politique et de tolérance sociale.
Evolution démographique. Le poids de cette évolution est relativement facile à évaluer. Les personnes âgées sont de plus en plus présentes dans les associations, surtout dans les syndicats. Elle créent aussi des organisations spécialisées représentant les intérêts des retraités. Les jeunes ont de moins en moins tendance à adhérer à ces associations existantes (ou à participer à la vie politique en général) ; ils contribuent en revanche de plus en plus au dynamisme des nouveaux mouvements sociaux au comportement « non conventionnel ». On constate par conséquent un déséquilibre croissant dans la répartition de la capacité organisationnelle et un mélange moins homogène des stratégies politiques d’une génération à l’autre. D'où une tendance à des politiques publiques conçues en faveur des personnes âgées et une résistance croissante aux réformes fiscales ou autres visant à redresser ce déséquilibre. Si les jeunes d’aujourd’hui qui délaissent la politique ne parviennent pas, en prenant de l'âge, à trouver des créneaux stables au sein de sociétés civiles réformées, nationales ou même supranationales, l’efficacité du régime et, en définitive, sa légitimité, en souffriront.
Performances économiques. Toutes les sociétés européennes, même les plus appauvries à l’Est, disposent de ressources humaines et matérielles suffisantes pour faire vivre une multiplicité d’organisations de la société civile. Le chômage élevé entraîne sans nul doute une diminution de la participation individuelle et fait peser de lourdes contraintes sur les organisations prestataires de services, que vient néanmoins généralement compenser une augmentation du travail bénévole et des contributions de personnes plus favorisées par la conjoncture. De même, les gouvernements sont plus dépendants des corps intermédiaires pour mettre en œuvre les programmes sociaux, ce qui augmente d'autant les recettes des associations. Le fait qu'en général, les performances économiques ont été inférieures à celles des Etats-Unis au cours des dix dernières années, ne semble pas avoir eu une grande incidence sur la société civile. Au contraire, cela n'a fait que ressortir le contraste en matière de qualité de vie entre l'Europe et les Etats-Unis, l'Europe étant la mieux placée compte tenu de son niveau élevé de solidarité sociale et d’organisation de la collectivité.
Mutations technologiques. Aucun des défis/perspectives n’a eu un plus grand impact sur la société civile que les avancées technologiques. De nombreuses organisations se sont emparées des innovations dans les TIC, qu'elles ont d'ailleurs contribué à généraliser dans le reste de la société. Il est devenu beaucoup moins coûteux et beaucoup plus facile de contacter les membres pour solliciter leur soutien. Des réseaux réunissant des initiatives locales, jusqu'ici isolées, sur de grandes distances et notamment à travers les frontières nationales ont été formés et se sont montrés efficaces pour coordonner l’action des militants au niveau de l’Europe. Mais les technologies de l’information et de la communication n’ont pas eu que des effets heureux. On ne sait pas encore précisément dans quelle mesure le temps passé à « surfer » sur Internet réduit le temps passé, surtout par les jeunes, à avoir des relations sociales. Les sollicitations adressées par courrier ou par Internet ont permis de créer et de financer un très grand nombre d'« associations et mouvements virtuels », dont les membres ne se rencontrent jamais et ne savent ni ne contrôlent quasiment rien de ce que leurs leaders font en leur nom. Nombre de ces organisations sont dominées par leurs salariés et gérées selon les mêmes principes que des entreprises à but lucratif, avec des « clients » qui bénéficient de certains biens et services en échange de leurs cotisations.
Capacité de l’Etat. Dans plusieurs des nouvelles démocraties, la principale question est de savoir si leur transition d’un régime autoritaire à la démocratie s'est accompagnée d'une modification des frontières géographiques et des identités collectives. Avec l’éclatement des anciens Etats multinationaux, s'est posé le problème de la coexistence de sociétés civiles plurielles au sein d’une même unité politique et de la perspective de relations « inciviles » entre celles-ci. Dans certains cas, la question s'est réglée pacifiquement par une sécession mutuellement acceptable. Mais, même alors, des clivages importants persistent généralement entre la nouvelle majorité nationale « titulaire » et les diverses minorités nationales. Pour la plupart des pays européens cependant, le problème a été plutôt inverse : comment des sociétés civiles nationales bien établies peuvent-elles faire face à la forte diminution de la capacité de l'Etat à s’acquitter de manière effective et autonome des missions que les citoyens attendent de lui. Il s’agit là d’un problème non pas de désintégration nationale mais d’intégration internationale. Que peuvent faire les organisations de la société civile lorsque l’Etat qu’elles cherchent à influencer fait partie d’un processus plus large de « souveraineté mise en commun » ? La réponse est simple : se réorganiser par delà les frontières nationales et élargir le champ de l’action collective. Malheureusement, il faut pour cela dépasser des différences profondes en matière de culture, de langue et d’organisation nationale. Mais, par ailleurs, la « société civile européenne » ainsi créée peut se montrer beaucoup moins efficace et moins encline à défendre les idéaux et les intérêts particuliers que ne l’étaient les sociétés civiles nationales.
Individualisation. Si ce problème était très grave, la société civile n’aurait aucune chance. Si les citoyens connaissaient tous des conditions de travail, des cadres de vie, des modèles de mobilité et des situations familiales très différentes, la probabilité d’agir collectivement et volontairement avec d'autres s'en verrait fortement diminuée. Heureusement, tel n'est le cas, les êtres humains semblant avoir un génie intrinsèque pour se découvrir de nouveaux objectifs communs. Il n'en est pas moins vrai que certaines des grandes catégories socio-politiques (« englobantes ») fondées sur la classe, la race, la religion, l’idéologie et la nationalité ont cédé la place à des conceptions plus fragmentaires et personnalisées des intérêts personnels et des idéaux collectifs. Cela explique probablement en partie le rythme soutenu auquel se créent de nouvelles associations et de nouveaux mouvements aux objectifs plus spécifiques, ainsi que le déclin progressif de formes plus traditionnelles d’association comme les syndicats. Cette évolution a un effet évident : les chances de conclure des « contrats sociaux » globaux sont moindres ; la négociation entre les différents intérêts et idéaux est donc moins encadrée et moins prévisible. Cela explique aussi pourquoi les liens des partis politiques avec les associations et les mouvements se délitent et pourquoi les premiers ont perdu beaucoup de leur fonction historique qui consistait à rassembler les citoyens sous de grandes étiquettes « idéologiques ».
Médiatisation. Auparavant, les composantes de la société civile jouaient un rôle important pour informer politiquement leurs membres et leurs adeptes, et pour les aider à se forger une conception de leurs intérêts et de leur identité. Actuellement, les médias – et surtout la télévision – ont usurpé cette fonction ; les informations spécialisées, quelles qu'elles soient, que proposent les associations et les mouvements, doivent généralement affronter la concurrence de sources commerciales rivales. La « presse de parti » a pratiquement disparu et les bulletins et les journaux des syndicats et des groupes professionnels ont un tirage de moins en moins important. Internet peut leur offrir de nouveaux moyens moins onéreux de faire passer leurs messages, mais la compétition pour attirer l’attention est féroce et les publics beaucoup moins captifs que dans le passé. La commercialisation peut banaliser l’information sur la politique (et en tirer matière à scandale), mais elle a aussi contribué à libérer les citoyens de la manipulation partisane et de la propagande gouvernementale. Pour ceux d’entre eux (dont le nombre, hélas, diminue) qui souhaitent participer de manière éclairée à la responsabilisation démocratique, il existe aujourd'hui des sources bien plus nombreuses, plus facilement accessibles et moins onéreuses mais elles ne permettent pas l'échange et le débat directs et interpersonnels qui caractérisaient autrefois la « sphère publique ».
Sentiment d’insécurité. Nous sommes face, là aussi, à un autre paradoxe. Dans le passé, rien n’était plus propre à créer l'union que la forme la plus menaçante d’insécurité, à savoir la guerre internationale. Lors des deux conflits mondiaux, on a constaté une augmentation considérable du taux d'adhésion à des organisations politiques et sociales de toutes sortes et l'apparition d'un grand nombre de nouvelles organisations pendant et immédiatement après ces épisodes de déchaînement de la violence. Maintenant que la guerre froide est terminée et que l’Europe a effectivement mis en place une « communauté internationale de sécurité » dans sa région, les pays qui la composent estimant avec réalisme que leurs différends ne sauraient être réglés par le recours à la force armée et qu'ils n'ont aucune raison de se faire la guerre, ce puissant moteur du développement de la société civile a disparu. Seule la perception de risques évitables et de leurs conséquences probables venant de nos voisins, donne lieu à de nouvelles formes d’action collective volontaire. Non seulement cette incitation est moins forte, mais elle est aussi porteuse de divisions. Son expression la plus manifeste dans l’Europe contemporaine est la mobilisation des autochtones contre les étrangers, et celle de ces étrangers en situation régulière ou irrégulière pour protéger leur personne et leurs droits.
Prise de décisions
« Garder les gardiens »
Dans les démocraties européennes contemporaines, des institutions non démocratiques ou non majoritaires jouent un rôle de plus en plus important. Nous nous pencherons dans cette partie sur les institutions prétendument « gardiennes » (institutions composées d’experts) et sur le développement d’une « gouvernance » en réseau, régulatrice et à plusieurs niveaux. Par « gouvernance », nous entendons des modèles de prise de décisions auxquels participent divers acteurs publics et privés dont les activités ne sont pas uniquement coordonnées par des mécanismes d'ordre hiérarchique et/ou commercial. Hormis et entre ces deux mécanismes traditionnels d'attribution des responsabilités, il existe une diversité de nouveaux modes de gouvernance qui utilisent différents systèmes de contrôle sur les résultats des politiques menées.
Légitimité démocratique, « gardiens » et gouvernance
Dans les sociétés modernes, la légitimité politique exige que les questions d’intérêt public et commun soient décidées démocratiquement. Pour qu'un système de gouvernance puisse être considéré comme démocratique, les opinions des citoyens doivent être librement représentées afin d'être entendues et respectées par les dirigeants qui, de leur côté, sont comptables de leurs actions et de leurs décisions devant les citoyens. En matière de légitimité démocratique, il est important que ces derniers pensent avoir une bonne chance d’influencer les décisions sur des questions concernant leur propre vie.
Cela n’implique pas que toutes les décisions collectives contraignantes doivent être prises démocratiquement. Même si elles ont une importance économique et sociale considérable, de nombreuses décisions sont considérées comme d'ordre privé et, à ce titre, reviennent aux personnes, aux familles et aux associations. Certaines de ces décisions sont laissées aux soins de dispositifs contractuels volontaires entre les parties concernées alors que d’autres sont prises par le biais de mécanismes de coordination plus automatiques comme le marché. En outre, la vie ordinaire des citoyens se déroule pour l'essentiel dans des structures organisationnelles, professionnelles, éducatives, religieuses et de loisirs qui fonctionnent généralement selon des principes hiérarchiques d’attribution des responsabilités. Les raisons pour lesquelles ces domaines de décision sociale échappent aux critères et aux procédures démocratiques relèvent de la vie privée, de l’efficacité organisationnelle et / ou de la complexité de la coordination. La validité de ces raisons dans ce contexte est souvent contestée, mais néanmoins largement acceptée comme appartenant à la vie démocratique.
Toutefois, la prise de décisions non démocratique s’étend à de nombreuses institutions publiques comme le système judiciaire, la police, l’armée et l’administration publique, qui sont généralement organisés selon des critères hiérarchiques, pour des raisons opérationnelles et à cause de la complexité organisationnelle de ces institutions. Mais les institutions publiques ne sont pas entièrement autonomes et elles ne fonctionnent pas exclusivement selon des règles autoréférentielles. Lorsqu’elles s’occupent des affaires publiques et qu’elles sont financées par des fonds publics, il est indispensable qu'elles aient une légitimation démocratique, garantie de l’extérieur par leur subordination aux gouvernements et aux parlements.
Au cours des vingt à trente dernières années, le champ décisionnel démocratique a connu une érosion constante due à des facteurs intérieurs et extérieurs à la politique. A l’intérieur, les limitations sont imposées par les institutions gardiennes qui s’occupent des problèmes politiques et réglementaires en s’appuyant sur un savoir spécialisé et sur des experts à l'écart de la concurrence partisane, de l’opinion publique et du système majoritaire de prise de décisions. Les limitations extérieures sont dues au fait que la décision en matière de politiques publiques passe de plus en plus souvent par des accords conclus au sein de réseaux complexes de gouvernance, comprenant des « partenaires » publics et privés, mais pas l'ensemble des citoyens en tant que tel. Toutes ces limitations entraînent une diminution de la responsabilité politique.
Cette évolution se traduit généralement par un glissement de la prise de décisions publiques et collectives, qui se déplace de la politique vers l’administration, de la démocratie vers la technocratie, en réduisant de facto sinon toujours de jure l’espace d'expression, d’influence et de contrôle des citoyens, qu’ils agissent directement ou indirectement par le biais de leurs élus. Ces changements ont été favorisés ou alimentés par des tendances inhérentes à la démocratie comme l’oligarchie, l’autonomie fonctionnelle, la corruption et la professionnalisation.
Tendance à l’oligarchie. La loi d'airain de l'oligarchie favorise clairement l’ascendant des institutions gardiennes. Plus que les partis politiques et les élus, elles échappent à la surveillance directe de l’opinion publique et, de ce fait, ne sont pas publiquement comptables de leurs activités.
Tendance à l’autonomie autoréférentielle. Cette tendance concerne la politique ainsi que d’autres domaines de la vie sociale, puisque la prise de décisions demande de plus en plus un savoir et une expertise spécialisés. Au lieu de règles générales contraignantes et égales pour tous, le processus politique tend à se fragmenter en des tâches fonctionnelles spécifiques, chacune ayant sa propre logique et ses propres besoins. En conséquence, les groupes d’intérêt organisés deviennent le seul point de référence pour les gardiens désignés pour réglementer leur comportement. Or, ces groupes privés ont tendance à rendre leurs gardiens « captifs » en exploitant les déséquilibres en matière d’information et de pouvoir.
Tendance à la professionnalisation. Cette évolution est commune aux cadres des institutions gardiennes et à la classe politique. Presque par définition, c'est à la nécessité de formes de savoir produites exclusivement dans le cadre de professions agréées ou spécialisées – avocats, économistes, théoriciens des systèmes, gestionnaires, comptables, officiers militaires, spécialistes des sciences sociales et ainsi de suite – que les institutions gardiennes doivent leur rôle. Notre analyse des tendances caractérisant les partis a montré que les responsables politiques deviennent, eux aussi, de plus en plus spécialisés ou dépendants des spécialistes : consultants, sondeurs d’opinion, conseillers en médias, etc…. Si les institutions gardiennes sont censées être indépendantes à divers degrés, elles sont aussi soumises au contrôle et à la pression du gouvernement. Lorsque les deux termes de cette équation sont plus professionnalisés, la tendance est bien sûr à l'exclusion des amateurs – c’est-à-dire la majorité de la population concernée – au motif qu’ils sont insuffisamment informés ou conscients de ce qui est nécessaire pour produire une « bonne » performance fonctionnelle.
Tendance à la corruption. C’est précisément le fait que les institutions gardiennes sont préservées des pressions publiques et isolées par leur expertise professionnelle, qui les rend exceptionnellement vulnérables à l’influence de la corruption. Ce phénomène est en partie inhérent à la prise de décisions spécialisée et compartimentée qui, par sa conception même, ignore les facteurs extérieurs et les conséquences imprévues. Ce qui semble rationnel et fonctionnel aux personnes directement concernées paraît relever de l'arbitraire et de l'exploitation à celles qui sont indirectement touchées. Mais, plus important, les institutions gardiennes sont chargées d’édicter les règles et d’accorder les autorisations. Cela crée des occasions très tentantes d'obtenir un avantage sur des concurrents ou même un statut de monopole pouvant se convertir en des profits exceptionnels, dont certains peuvent même être restitués aux autorités chargées de la réglementation et de la délivrance d'autorisations.
Le tableau 1 résume la manière dont les dix « défis et perspectives » décrits au chapitre I fournissent le terreau du développement de formes non démocratiques de gouvernance. Il regroupe les « défis et perspectives » en quatre grandes catégories. La première concerne les effets de la mondialisation de la gouvernance et du déclin de la souveraineté de l’Etat ; la deuxième la porosité croissante entre le privé et le public. La troisième concerne les difficultés qu’entraîne la multiplication des niveaux de différenciation sociale pour la politique démocratique. La quatrième et dernière décrit les effets des nouvelles technologies (mais aussi de l'augmentation des risques et de l'insécurité) sur la relation entre les Etats et pouvoirs privés, d’une part, et les citoyens, d’autre part.
Tableau 1 : Transformations du contexte extérieur: impact sur les structures de gouvernance et les institutions gardiennes
Défis et
perspectives
|
Mondialisation
Intégration européenne
Capacité de
l’ Etat
|
Mondialisation
Intégration européenne
Capacité de l’Etat
Performances économiques
|
Immigration et coexistence interculturelle
Evolution démographique
Individualisation
|
Mutations technologiques
Médiatisation
Sentiment d’insécurité
|
|
Institutions
gardiennes
et de
gouvernance
|
Les processus de mondialisation et d’internationalisation ont contribué à donner un rôle plus important aux institutions gardiennes et de gouvernance.
Le pouvoir de l’Etat diminue dans la mesure où il doit coordonner ses politiques avec d’autres Etats et de puissantes entreprises privées au niveau national et international.
|
L’effet combiné de ces défis modifie la relation entre le public et le privé, en réduisant le rôle de direction et de sanction des institutions publiques.
Pour être efficaces, les institutions politiques ont besoin d’instruments plus flexibles visant à modifier les modèles comportementaux, lorsqu’elles ne peuvent pas utiliser de stratégies s’appuyant sur la hiérarchie.
|
Il est plus difficile pour les institutions démocratiques de répondre à des besoins et à des attitudes de plus en plus différenciés.
Les institutions chargées de résoudre les problèmes sont considérées comme plus efficaces face à la diversité.
|
Les modifications du
contexte de l’information
et de la communication
publiques ouvrent de
nouvelles possibilités de domination à l’Etat et
au privé.
Mais ces nouvelles
technologies rendent aussi plus difficile
à un seul pouvoir de contrôler le flux de l’information.
Les nouvelles technologies abaissent les coûts de transaction permettant
l’obtention d’informations et un
gouvernement transparent.
|
Analyse
Ces tendances internes et ces évolutions extérieures favorisent la prolifération des institutions gardiennes et de gouvernance. L’effet de ces institutions sur l’efficacité et la responsabilité démocratiques est analogue à celui que produisent les institutions administratives et bureaucratiques traditionnelles. Elles prolongent la chaîne de délégation : plus la chaîne est longue, moins la voix des citoyens se fait entendre. Elles ont tendance à contrôler l’information et à agir comme si elles avaient le monopole du savoir et de l’expertise dans tel ou tel domaine. Elles ne sont pas directement comptables de leur action puisqu’elles échappent à la discipline électorale. Or, ces nouvelles institutions sont encore plus indépendantes du pouvoir politique que les organismes bureaucratiques traditionnels. Créées pour éviter la politisation, elles sont moins responsabilisées à cause de la fragmentation de la responsabilité politique, dans le cas de la gouvernance en réseau.
Devant l'emprise croissante de ces institutions sur les décisions publiques, l’avenir de la démocratie dépendra de la manière dont nous règlerons les questions suivantes :
1. La perte apparente de légitimité démocratique peut-elle être compensée par d’autres formes de légitimité sur lesquelles s'appuient les institutions « gardiennes » et « de gouvernance » ?
2. Les institutions gardiennes/de gouvernance non majoritaires peuvent-elles être conciliées avec des réformes des pratiques démocratiques, et peuvent-elles être justifiées par celles-ci ?
Pour répondre à la première question, nous devons pointer les arguments généralement avancés pour justifier que l’élaboration de politiques soit déléguée à des institutions non démocratiques. Comme dans le cas de l’administration publique, du système judiciaire et de l’armée, la principale justification est la nécessité d’une efficacité organisationnelle. Mais cet argument plutôt général ne saurait être appliqué à toutes les institutions gardiennes ni à la gouvernance en réseau en général.
D’un point de vue analytique, les raisons données pour défendre les institutions non majoritaires reflètent les critères qui régissent la prise de décisions publiques dans les sociétés développées et les règles encadrant l'élaboration des politiques publiques. Ces critères sont principalement ceux de la complexité et du savoir spécialisé. Les règles sont la faisabilité, l’efficacité et l’efficience, le respect de la diversité des besoins ou des identités, le respect de la diversité des modes d'application, l’autonomie privée et la liberté d’entreprise. A cause de ces critères et de ces règles, la légitimité politique se fonde moins sur la participation, l’accès aux droits et la responsabilité démocratiques que sur l’exercice plus efficace des fonctions et la satisfaction découlant de la meilleure qualité des résultats.
Le tableau 2 expose les arguments sur lesquels repose la légitimité « fonctionnelle et substantielle » des institutions gardiennes et de gouvernance. Il organise celles-ci selon le type d'arguments (critères et règles) justifiant leurs fonctions, et selon le type de contraintes (internes ou extérieures) qu’elles imposent à la politique démocratique.
Ce tableau montre que la légitimité fondée sur les résultats et les fonctions demande aux institutions d’œuvrer à la place des citoyens au lieu de les représenter. Mais cela semble supposer que les démocraties modernes seraient face à un compromis entre les institutions qui privilégient la légitimité démocratique et celles qui privilégient la légitimité fondée sur les résultats et les fonctions. En conséquence, l’équilibre du pouvoir penche maintenant de manière très nette du côté des institutions non démocratiques (et potentiellement oligarchiques), en amenuisant le sentiment qu’ont les citoyens de pouvoir influencer les décisions collectives.
Tableau 2 : Arguments justifiant la légitimité non démocratique
|
|
Critères
Complexité
Savoir spécialisé
|
Règles
Faisabilité
Efficacité/efficience
Diversité des besoins et des identités
Diversité des modes d' application
Autonomie privée et liberté d’entreprise
|
De l’intérieur du système politique
|
Institutions protégeant la démocratie
Prise de décisions dans des domaines hautement spécialisés
|
Institutions protégeant les minorités
Institutions protégeant les individus
|
De l’extérieur du système politique
|
Décisions impartiales
Coordination complexe
Promotion de la concurrence et de ses conditions
Coopération supranationale
|
Décisions impartiales
Contrôle du marché
Promotion de la concurrence et de ses conditions
Coopération supranationale
|
Il est une autre manière d’envisager les institutions gardiennes et de gouvernance, en ne se limitant pas aux arguments qui les justifient mais en partant du point de vue plus concret des fonctions dont elles s’acquittent en rapport avec le système politique et les intérêts et le bien-être de la population. Il s’agit d’une perspective beaucoup plus prometteuse sous laquelle aborder notre deuxième question : est-il possible de concilier les mécanismes « gardiens » et de gouvernance avec la légitimité démocratique en réformant les pratiques des démocraties libérales « réelles » ?. Le tableau 3 montre ce que ces institutions font en matière de prise de décisions publiques.
Tableau 3 : Types d’institutions décisionnelles non démocratiques
Institutions à l’intérieur du système politique
|
Institutions à l’extérieur du système politique
|
Institutions chargées de mettre en œuvre les politiques publiques
|
Institutions de réglementation
|
Institutions exerçant un contrôle sur le système politique administratif
|
Institutions autorégulatrices
|
Institutions semi-autonomes, agissant dans des domaines revêtant un grand intérêt public
|
Réseaux de prise de décisions
|
Le tableau 3 montre que la tendance à la bureaucratisation et à la rationalisation de la politique, théorisée par Max Weber dès le début du XXe siècle, ne s’incarne plus exclusivement dans les ministères et les organismes de l’administration publique traditionnelle, mais de plus en plus dans les institutions gardiennes et les réseaux de gouvernance qui vont en se multipliant. Ce glissement de la politique à l’administration (de l’approche du conflit et du compromis à l’approche du règlement des problèmes et de la mise en œuvre des mesures) est accentué par la nécessité de ne pas surcharger le système politique de tâches législatives et réglementaires devenues trop lourdes dans des sociétés modernes complexes. Il reflète également la propension des responsables politiques à fuir leurs responsabilités et à déléguer l'élaboration des politiques à des institutions non démocratiques dans les domaines où le succès est difficile à établir et où les résultats ne peuvent se traduire aisément en atouts électoraux.
Mais si ni les citoyens ni leurs élus n'ont de contrôle sur ces nouvelles institutions, la question est de savoir comment faire pour que les « gardiens » n’outrepassent pas leurs fonctions en exploitant à leur avantage leur position privilégiée. Qui, en définitive, garde les gardiens ? Quis custodiet ipsos custodes ? Le tableau 3 montre qu’il n’existe pas une seule solution unique ou universelle, puisque les institutions gardiennes et les réseaux de gouvernance qui s’acquittent de fonctions différentes, exigent des stratégies différentes pour concilier la légitimité démocratique et la légitimité fonctionnelle.
Le tableau 4 propose deux stratégies générales que l’on pourrait utiliser pour régler ce problème. L’une, plus directe, vise à réintroduire des formes de contrôle et de responsabilité démocratiques. L’autre, plus indirecte, joue sur l’équilibre des pouvoirs.
Tableau 4 : Stratégies pour réintroduire la démocratie
|
|
Stratégies directes
|
Stratégies indirectes
|
Fondées sur le système politique
|
Soumettre les institutions gardiennes au contrôle direct de corps démocratiquement élus
|
Promouvoir un système horizontal d’équilibre des pouvoirs, fondé sur la vigilance réciproque entre les institutions gardiennes et démocratiques
|
Fondées sur le citoyen
|
Concevoir des mécanismes autres que le contrôle électoral garantissant la participation et le contrôle populaires
|
Promouvoir des institutions qui procèdent à un contrôle vertical des institutions politiques en permettant l’expression de la volonté des citoyens
|
Responsabilisation aux différents niveaux de pouvoir et décentralisation
On expérimente de plus en plus, en Europe, des formes de gouvernance à plusieurs niveaux en partie par suite du transfert de compétences aux autorités régionales ou provinciales, en partie parce que l’Union européenne a montré que la souveraineté nationale peut être répartie et mise en commun dans l'intérêt de tous les niveaux. Mais les idéaux démocratiques sont bousculés par ces expériences sur les différentes échelles de gouvernance. Comment rendre les politiques responsables de leurs actes ? Comment concilier la règle « une personne, une voix », avec des sous-unités de différentes tailles exigeant d’être entendues à égalité ? Comment régler la question de savoir quelles décisions doivent être prises par quel demos et à quel niveau géographique, et à qui incombe le soin de trancher les inévitables conflits résultant d'un un système aussi complexe ?
La gouvernance à plusieurs niveaux et la décentralisation remettent en cause les règles démocratiques de responsabilisation de la classe politique et d’autres autorités à différents niveaux, parce que ce système tend à brouiller les espaces de choix politique dont bénéficie chaque niveau. Parmi les mesures visant à rétablir la responsabilité, il convient entre autres d'accroître la transparence et la contestation politique à l’égard des décideurs, qu’il s’agisse de leurs pouvoirs de jure ou de leurs possibilités de choix de facto.
Analyse
La « gouvernance à plusieurs niveaux » est un terme souvent utilisé pour décrire la multiplicité des modes de prise de décisions au sein de l’Union européenne. Par « plusieurs niveaux », on peut entendre la dissémination « verticale » de l’autorité politique de l’Etat vers un niveau supranational – l'Union européenne – et les niveaux infranationaux/régionaux ; et/ou la dispersion « horizontale » lorsque des acteurs non étatiques participent au processus. Cela soulève divers problèmes normatifs concernant des questions comme la représentation et la responsabilité démocratiques, parce que les prétendues vertus d’une gouvernance disséminée ont un coût : une diminution de la transparence et une définition plus floue des compétences et des responsabilités.
Dans l’optique qui nous intéresse, les ordres politiques fédéraux peuvent être caractérisés par une division (quasi) constitutionnelle des pouvoirs entre l’organe central et des sous-unités, où chaque niveau a l’autorité finale en ce qui concerne certaines fonctions, toute modification de cette répartition de l’autorité devant être approuvée de tous. Dans les systèmes décentralisés, les autorités centrales peuvent au contraire conserver, modifier ou supprimer à leur gré des échelons de compétence inférieurs. Dans les organisations confédérales, les sous-unités peuvent généralement opposer leur veto aux décisions prises et même quitter la confédération. Les institutions de l’Union européenne, qui ont leur origine dans la Communauté européenne du charbon et de l’acier, comportent à la fois des éléments fédéraux et des éléments confédéraux.
Certes, l’Union européenne ne deviendra peut-être jamais une fédération à part entière dotée d'une division complète des pouvoirs, mais son projet de traité constitutionnel ajoutera, s’il est ratifié, des ingrédients fédéraux supplémentaires au « mélange », puisque les Etats membres auront renoncé à leur droit de veto dans un plus grand nombre de domaines.
Une des questions les plus délicates au sein de toute fédération ou de quasi-fédération est l’attribution officielle (généralement constitutionnelle) de compétences à ses multiples niveaux de décision politique. Le principe de subsidiarité prétend résoudre ce problème en plaçant la charge de l’argumentation sur ceux qui veulent centraliser l’autorité. La souveraineté peut être mise en commun pour remédier à la perte de capacité effective de gouvernement des petites sous-unités. Mais les autorités supérieures, nationales ou supranationales, ne peuvent agir légitimement que lorsqu’elles contribuent à satisfaire les objectifs des citoyens mieux que ne le font les sous-unités. L’application de ce principe a connu bien des interprétations différentes et contradictoires ; pour n’en citer que quelques-unes : la pensée catholique moderne, la tradition antique à laquelle se rattache Althusius, la doctrine des « majorités concurrentes » liée au conflit entre le Nord et le Sud des Etats-Unis, ou encore des conceptions contemporaines telles que le fédéralisme fiscal et le contractualisme libéral. Ces interprétations divergent sur des questions fondamentales : quels sont les justes objectifs de l’ordre politique ? comment pondérer des sous-unités de différentes tailles et capacités ? faut-il définir ces unités en termes territoriaux ou fonctionnels ? quels sont les modes de protection et de subventionnement entre niveaux les plus efficaces et contre quels risques ? Par exemple, la tyrannie exercée par les autorités centrales sur une sous-unité est-elle pire que celle exercée par des collectivités locales sur une minorité locale ? A quel stade la meilleure exécution d’une tâche fonctionnelle contrebalance-t-elle la menace pesant sur l’identité et l’autonomie territoriale ? Qui doit être le juge ultime lorsqu’il y a conflit sur l’application des règles : les dirigeants des sous-unités ou ceux du pouvoir central ? Et surtout, pour ce qui nous occupe, qui doit être tenu pour responsable (et comment), notamment lorsque de nombreuses décisions supposent davantage un partage qu’une séparation des compétences ?
En dernier lieu, l’attrait du principe de subsidiarité repose pour l’essentiel sur notre passion commune pour la liberté, l’idéal selon lequel nul ne doit être soumis à la volonté arbitraire d’autrui. Accorder et protéger le droit de veto de toutes les sous-unités permettrait de préserver la liberté en garantissant que les avantages communs ne sont pas obtenus au prix du despotisme, mais cela laisserait aussi l’ensemble du système politique à la merci d’une seule sous-unité réfractaire. D’autres prétendent que la décentralisation vers des groupes plus petits partageant des préférences politiques, des valeurs individuelles et/ou des conditions matérielles permet une prise de décisions plus efficace. Mais précisément à cause de ces caractéristiques communes, ces unités peuvent ne pas avoir la quantité ou la diversité de ressources nécessaires pour s’attaquer au problème posé. Le transfert des pouvoirs permet d'éviter de surcharger le processus de prise de décisions, mais il peut aussi en faire un processus plus particulariste et oligarchique. Des sous-ensembles d’individus pourraient être autorisés à former des « clubs » pour la fourniture de certains biens publics mettant en jeu de nombreuses « internalités positives » (appelées aussi « synergies »), mais à condition qu’ils n’excluent pas les minorités des bénéfices et ne fassent pas payer les coûts à des non-membres.
Il est souvent difficile de déterminer qui assume en dernier lieu la responsabilité de telle ou telle décision politique si plus d’un niveau participe à son élaboration et à sa mise en application et que chaque niveau d’autorité peut en rendre l’autre responsable. Une structure aussi complexe fait qu’aucun système officiel de « diplomatie à plusieurs niveaux » n'est en mesure de satisfaire la condition démocratique de « responsabilité des actes accomplis dans la sphère publique » ni d'imposer les sanctions nécessaires à ceux qui agissent dans les interstices entre les différents niveaux. Néanmoins, d’un point de vue normatif, il est possible de préciser les règles générales d’évaluation de cette complexité.
Transparence vs opacité. Avec l'aide des médias publics, la population et les autorités devraient pouvoir déterminer si les institutions et leurs décisions obéissent dans les grandes lignes aux critères normatifs appropriés pour cet ordre politique complexe. Une cause supplémentaire d’opacité au sein de l’Union européenne est que nombre des processus se sont déroulés jusqu’à présent sans que le public ait pu accéder aux négociations gouvernementales au sein du Conseil des ministres. En outre, le passage de l'unanimité à la majorité (qualifiée) limite encore plus la responsabilité puisqu’il permet aux responsables politiques de dire qu’ils n’ont pas réussi à faire prévaloir leur vote contre des décisions impopulaires. Il n'est en effet pas facile de vérifier leurs allégations quand ils prétendent qu’ils ont dû se soumettre « à la contrainte de Bruxelles ».
Sécurité vs insécurité. L’unanimité protège les citoyens de chaque Etat membre en leur évitant de participer contre leur gré à des accords contraires à leurs propres intérêts, et les préserve dans une certaine mesure des décisions unilatérales. Mais cette règle accroît aussi l’incertitude et la vulnérabilité des citoyens puisque chaque sous-unité peut bloquer des décisions communes. Le vote à la majorité (qualifiée) demande en revanche une plus grande confiance et une plus grande fiabilité chez les citoyens et leurs représentants. Il exige en effet que, de temps à autre, ces derniers révisent ou sacrifient leurs intérêts et ceux de leurs électeurs pour le bien d’autres Européens. Il faut donc, dans ce cas, compter sur le fait que la majorité tiendra compte des difficultés de la minorité et qu’elle respectera les décisions communes lorsqu’elle deviendra elle-même minoritaire.
Autonomie vs égalité. Une tension s’exerce entre le respect de l’autonomie des sous-unités et la garantie de conditions de vie à peu près égales d’une sous-unité à l’autre – ce que l’on considère souvent comme une condition et/ou un objectif de la politique démocratique. Il est donc essentiel de définir le type de résultats et de politiques dont la population de la sous-unité doit être responsable, c'est-à-dire pour lesquels elle doit supporter le fardeau économique intégral de ses choix collectifs. L’Union européenne est censée « promouvoir la cohésion économique et sociale et la solidarité entre ses Etats membres » – tout en respectant leur autonomie. Mais la péréquation et la solidarité peuvent exiger la centralisation des politiques monétaires, sociales et fiscales – conformément au principe de subsidiarité – ce qui ne laisse guère de pouvoir à la sous-unité.
« Une personne, une voix » vs « une sous-unité, une voix » ? Les tentatives de « démocratisation » des fédérations comportant des sous-unités de taille inégale peuvent porter atteinte aux idéaux démocratiques : lequel de ces deux principes doit prévaloir : « une personne, une voix » ou « une sous-unité, une voix » ? Autrement dit, les normes démocratiques exigent-elles que l’on applique la règle de la majorité ou peut-on justifier que de petites sous-unités soient sur-représentées, par exemple pour que les intérêts de leurs citoyens risquent moins d’être systématiquement négligés ? Cette sur-représentation, fréquente dans les fédérations, pourrait être défendue dans les institutions de l’Union européenne, où des Etats moins peuplés sont sur-représentés ou ont un poids électoral disproportionnellement élevé par rapport à des pays plus peuplés. Il n’est pas évident que la prise de décisions à la majorité soit appropriée lorsque certaines catégories de la population risquent d’être constamment minoritaires, surtout si l’on ne peut compter sur la majorité pour qu’elle tienne compte, dans ses choix, de leurs effets sur les minorités. Dans ces circonstances, le principe « une personne, une voix » pourrait ne pas être la bonne solution.
Mécanismes de consultation directe des citoyens et référendums
Les diverses formes de démocratie représentative constituent le fondement de la prise de décisions dans toutes les démocraties européennes – anciennes ou nouvelles – mais certains systèmes ont en outre introduit des mécanismes de participation directe des citoyens dans l’arsenal de leurs institutions démocratiques. Dans presque tous les pays européens et à presque tous les niveaux de gouvernement, les citoyens peuvent faire des pétitions qui ne sont pas contraignantes pour les parlements et qui ne débouchent pas sur des votes populaires. Ces pétitions sont l’expression populaire, superficielle et non menaçante de mécontentements et de conflits sociaux profonds. Ces manifestations sont généralement canalisées par les organisations politiques traditionnelles (partis, associations, mouvements), mais elles sont occasionnellement imputables à des groupes d’action collective informels et créés pour la circonstance. Elles ont pour objectif premier d’attirer l’attention des dirigeants et de susciter le débat public parmi les citoyens. Le succès de ces pétitions restant entièrement à l’appréciation des personnes au pouvoir, elles ne sont qu’un mode de communication vers le haut, comme plusieurs autres proposés par les démocraties libérales tels que les sondages d’opinions et les auditions publiques. Sans doute certaines pétitions sont-elles plus efficaces que d’autres, mais aucune ne peut être considérée comme un moyen régulier et efficace d'engager la responsabilité des dirigeants.
Dans la version traditionnelle de la théorie démocratique libérale, le mécanisme qui, par excellence, garantit la responsabilité sont des élections « libres et équitables », « régulières et concurrentielles ». La question de savoir si des élections périodiques suffisent à elles seules pour atteindre cet objectif, est depuis longtemps controversée – au moins depuis que Jean-Jacques Rousseau a remarqué caustiquement que les Anglais n’étaient libres que toutes les quelques années, le jour où ils votaient. Indépendamment de l’argument théorique, la plupart des démocraties « réelles » d’Europe ont dans la pratique conçu et appliqué d’autres moyens pour réguler la conduite (et, occasionnellement, le mandat) de leurs dirigeants. De nos jours, ce que l’on a fini par appeler la « démocratie directe » complète « la démocratie indirecte ou représentative » dans presque tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.
Les institutions de la démocratie directe sont essentiellement de deux ordres : le référendum et l’initiative populaire, tous deux étroitement corrélés. Par référendum, on entend un processus par lequel des propositions faites par des autorités politiques peuvent être soumises à un vote populaire. L’initiative populaire est un processus par lequel un certain nombre de citoyens peuvent formuler une proposition et contraindre les autorités politiques à la soumettre à un vote populaire. Dans ce dernier cas, il existe une forme spéciale d’initiative, la procédure de révocation, appliquée non pas à une proposition particulière mais au mandat de tel ou tel élu. Ainsi, ce sont les auteurs de l’initiative qui nous permettent de distinguer entre les deux formes de démocratie directe, et non leur contenu ou leur objectif.
Les qualités et les défauts du référendum et de l’initiative populaire font depuis longtemps l’objet de débats entre les spécialistes de philosophie politique et les théoriciens des normes démocratiques. Les arguments pour et contre ces procédures ont été développés à l’envi au cours des derniers siècles. La notion de « révocation » est particulièrement controversée, parce que c’est elle qui renvoie le plus à la notion de responsabilité. Comme nous venons de le voir en Californie, elle peut être utilisée pour révoquer un responsable élu tout à fait légalement, qui a le soutien de la majorité d’un parlement lui aussi légalement élu. Indépendamment de l'issue d’un débat abstrait sur la démocratie directe, celle-ci est devenue de plus en plus une réalité au cours des dernières décennies en Europe.
Le principal problème que pose la démocratie directe à la démocratie représentative est qu’elle introduit un veto potentiel supplémentaire dans les mécanismes d’équilibre des pouvoirs prévus dans le système indirect de représentation. Des décisions prises par des représentants légitimement élus peuvent être modifiées ou tout bonnement abandonnées. De plus, le parlement perd (ou voit se réduire) sa souveraineté traditionnelle au sein du système démocratique, puisqu’un vote favorable sur une initiative populaire peut déboucher sur une décision généralement contraignante ou obliger le parlement à produire une telle décision. Si – pour reprendre la terminologie de Gordon Smith – les « résultats anti-hégémoniques » des votes populaires devaient devenir la règle, la démocratie risquerait de se retrouver dans une impasse. Sur le plan normatif, ce serait certainement sous-optimal au sens de Pareto. Tout le monde risquerait d'y perdre ou, du moins, la probabilité que des décisions bénéficiant à tous soient adoptées serait plus faible.
La situation inverse n’est guère plus attrayante ou vraisemblable. S'il était de règle que les choix des élus et des citoyens soient identiques – ou, du moins, systématiquement en harmonie - le référendum et l’initiative populaire seraient tous deux inutiles. Dans un monde idéal où tous les principes de la démocratie seraient parfaitement respectés par tous les acteurs et où la délibération politique déboucherait sur une information parfaite et une compétence politique partagée par tous les citoyens, l’harmonie des politiques (et le consensus de l’opinion) serait le résultat naturel. Il n’y aurait donc guère de raison d’organiser des référendums populaires sur certaines questions alors que les dirigeants et les citoyens parviendraient de manière systématique et prévisible aux mêmes conclusions.
En tout état de cause, une démocratie aussi parfaite reste une chimère. Même le simple fait de faire coïncider durablement une majorité d’élus et une majorité de citoyens peut être difficile. Au demeurant, l’harmonie systématique, lorsqu’elle se manifeste formellement, est probablement moins saine pour la démocratie ; elle indique généralement un contrôle autocratique de l’élite dirigeante sur des sujets obéissants et apeurés. Par exemple, le référendum de 1986 de Ceausescu en Roumanie a donné un total parfait de 100 % de « oui » avec une participation électorale de 99,99 %. Or, ce dirigeant plébiscité triomphalement a été renversé à peine trois ans plus tard, à la satisfaction générale des Roumains.
Malgré une idéologie qui insiste sur l’harmonie entre les choix des dirigeants et les préférences des citoyens, et qui suppose que les élus se fassent l’écho sans ambiguïté des électeurs, on peut penser, d’après la pratique de toutes les démocraties « réelles », qu’il est normal (ou certainement assez fréquent) que les deux ensembles d’acteurs démocratiques ne soient pas synchrones, en partie à cause de différences en matière d’horizon temporel ou de définition de l’électorat. Dans l’ensemble, toutefois, cela est dû aux inévitables négociations, compromis, « renvois d’ascenseur » et « offres globales » qui font partie intégrante du fonctionnement de la démocratie représentative. En outre, à mesure que les responsables politiques se professionnalisent et acquièrent de l'expérience, ils apprennent comment conclure ces accords (et à se souvenir plus nettement des accords passés). Ils deviennent aussi plus habiles pour expliquer à leurs mandants et aux électeurs les raisons de ces déphasages.
Il ne fait guère de doute qu’entre la professionnalisation des responsables politiques et la complexité des choix collectifs dans les démocraties contemporaines à plusieurs niveaux, les déphasages se multiplient et que le sentiment qu’ils génèrent chez les citoyens est l’un des nombreux éléments qui contribuent à généraliser le mécontentement à l’égard des dirigeants et la méfiance à l’égard des élus. Pour remédier à ce problème, l’une des solutions, peut-être la meilleure, consisterait à insérer des formes de démocratie directe pour compléter la démocratie représentative. Un subtil avantage de la démocratie directe est que le référendum et l’initiative populaire peuvent avoir une influence considérable même lorsqu’ils ne sont pas expressément utilisés. Le seul fait d’anticiper leur organisation – par le gouvernement, l’opposition ou un nombre suffisant de citoyens – peut être suffisant pour dissuader les dirigeants d’adopter des mesures dont ils savent qu’elles ne sont pas conformes aux préférences d’une majorité jusqu’ici passive.
Dans de nombreux systèmes politiques, le lancement du processus référendaire est rigoureusement contrôlé par le chef d’Etat ou de gouvernement. On en use (et on en abuse) pour inviter les électeurs à se rendre aux urnes à condition qu'il soit impossible qu’ils votent « non », par peur ou par manipulation. Dans de nombreux pays africains post-coloniaux à parti unique, le référendum est utilisé par les dirigeants, selon leur bon plaisir, comme un outil de légitimisation démocratique de leurs décisions. Dans un passé assez récent, on a même vu des gouvernements d’Europe occidentale recourir à cet instrument « plébiscitaire ». Cette version ad hoc (et parfois ad hominem) de la démocratie directe contraste fortement avec ses formes plus formalisées et plus prévisibles appliquées ailleurs. Dans des pays européens comme la Suisse, le Liechtenstein, l’Italie, l’Irlande, le Danemark, les démocraties post-communistes d’Europe centrale et orientale et la plupart des républiques de l’ex-Union soviétique, le gouvernement en place n'a pas la maîtrise du lancement d’un référendum. Par exemple, pour modifier la constitution ou adhérer à l’Union européenne ou à d’autres organisations régionales ou planétaires, il est tenu d'organiser un référendum dont les règles sont fixées bien à l’avance. Les initiatives populaires exigent la collecte d'un nombre préétabli de signatures par les citoyens, qui ne peut être manipulé ex ante ou annulé ex post par les personnes au pouvoir.
Même un observateur superficiel de la vie politique européenne récente ne peut ignorer certains référendums nationaux qui ont eu une influence déterminante sur des questions comme l’avortement, l’énergie nucléaire, l’adhésion à l’Union européenne, et ainsi de suite. On néglige souvent le rôle politique primordial joué par les référendums (et, plus rarement, par les initiatives populaires) au niveau local et régional dans les démocraties bien assises. En Europe occidentale, on a généralement mis en place et expérimenté des mécanismes de démocratie directe à ces niveaux avant de les transposer au niveau national. En Europe centrale et orientale et dans les républiques de l’ex-Union soviétique, le brusque changement de régime, qui est passé de l’autocratie communiste à la démocratie libérale, a entraîné en revanche une extension immédiate des droits populaires au niveau national, avant toute expérimentation préalable à l'échelon local ou régional.
Votes populaires en Europe : évaluation des faits
Entre 1960 et 2003, dans l'ensemble des Etats qui sont actuellement membres du Conseil de l'Europe, les citoyens ont été invités à prendre 628 décisions démocratiques directes au niveau national. Ces données montrent qu’au cours des quarante dernières années, des initiatives populaires et des référendums nationaux ont été organisés dans trente-neuf des quarante-cinq Etats membres. Si l'on inclut les données au niveau local et régional, le Luxembourg serait le seul pays européen à n'avoir jamais consulté directement sa population par le biais de ces mécanismes. Mais même le Luxembourg a organisé trois référendums nationaux avant 1960, et son gouvernement a récemment annoncé qu’un référendum serait organisé sur le projet de constitution européenne. Toutes les démocraties européennes ont connu, au moins sporadiquement, des consultations populaires – même si leur fréquence, leur forme et leurs effets ont été très variés.
Plus de la moitié des référendums et initiatives populaires qui ont eu lieu en Europe depuis 1960 ont été organisés en Suisse. Ce pays est le champion du monde de la démocratie directe et, pour avoir cette réputation bien méritée, il a suivi une trajectoire politique très particulière. C’est pourquoi nous avons choisi d’exclure cet exemple extrême de la plupart de nos analyses.
Hormis la Suisse, le Liechtenstein et l’Italie, seuls cinq des pays européens ont organisé au moins 10 référendums pendant la période en question. A l’exclusion de la Suisse, la moyenne par pays a été de sept. Seulement un quart des Etats membres du Conseil de l’Europe ont dépassé cette moyenne. En d’autres termes, le nombre des référendums nationaux a été relativement faible dans la plupart des Etats membres.
La figure 6 ci-dessous montre l’évolution de la fréquence des consultations populaires depuis 1960. Elle nous permet d’observer leur dynamique sur le temps au sein de l’Europe. Le point 2000-2009 est une projection linéaire fondée sur les données de 2000-2003.
Figure 6 : Tendance globale en matière de scrutins de démocratie directe dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe (Suisse incluse et Suisse exclue) 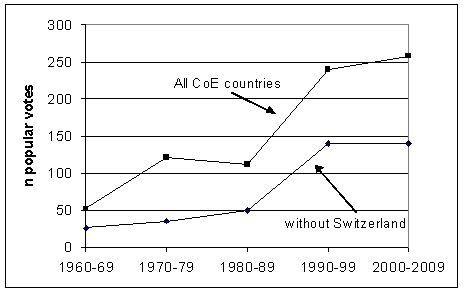
Sources: Centre de recherche et de documentation (c2d) de l’université de Genève et la “Suchmaschine für direkte Demokratie” mise au point par Beat Müller à l’Institut fédéral suisse de technologie à Zurich
Les deux courbes de la figure 6 ont un profil similaire. L’inclusion de la Suisse double les chiffres sans modifier de manière significative la forme en S de la courbe de base. Les deux révèlent une augmentation considérable des consultations directes des citoyens au cours des années 1990. La fréquence globale a triplé pendant cette période, dont on peut supposer qu'elle correspond à un moment critique de la politique européenne où les référendums et les initiatives populaires ont été particulièrement prisés comme instruments de règlement des conflits et de légitimation. Depuis, la fréquence s’est toutefois stabilisée et nos projections laissent penser que, pour les dix premières années du troisième millénaire, leur nombre n’augmentera probablement pas. Une hypothèse est que l’Europe a atteint un « point de saturation » concernant la prise de décisions par des formes de démocratie directe, point où un certain équilibre s'établit entre celle-ci et la démocratie représentative.
Figure 7 : Tendance globale en matière de scrutins de démocratie directe en Europe occidentale et en Europe orientale et centrale (tous les pays du Conseil de l'Europe sauf la Suisse)

Sources : Centre de recherche et de documentation (c2d) de l’université de Genève et la “Suchmaschine für direkte Demokratie” mise au point par Beat Müller à l’Institut fédéral suisse de technologie à Zurich.
Cette constatation peut être illustrée par le modèle d’évolution des anciennes et des nouvelles démocraties européennes. A la figure 7, nous observons une nette convergence de la fréquence des référendums tenus en Europe occidentale et en Europe orientale depuis la fin de la guerre froide. Pour l’Ouest, l’augmentation massive des années 1990 s’explique avant tout par une série de référendums sur l’intégration dans l’Union européenne. A l’Est, l’augmentation est due à des consultations populaires sur la souveraineté nationale et les constitutions. Nos projections sur dix ans prévoient à peu près le même nombre de référendums dans les deux « Europes » au cours des dix premières années du troisième millénaire, ce qui s'explique là encore et entre autres par l’intégration européenne. Tant que les Etats membres de l'UE continueront d'adopter de nouveaux traités, leur ratification entraînera inexorablement une succession de référendums. Par exemple, l’introduction de l’euro a fait l'objet de votes populaires au Danemark et en Suède (cela pourrait un jour être aussi le cas au Royaume-Uni). Pour 2003 seulement, l’élargissement de quinze à vingt-cinq Etats membres a obligé neuf des dix nouveaux venus à organiser des référendums, à la seule exception de Chypre. Le Conseil des Ministres ayant maintenant convenu du texte d'un nouveau « traité constitutionnel », on peut prévoir qu’un nombre encore inconnu mais important d’Etats membres permettront à leurs citoyens de voter directement sur sa ratification.
Mais l’intégration européenne par des traités successifs n’est pas le seul facteur de promotion des référendums en Europe. Le Liechtenstein, l’Italie et l’Irlande (ainsi que, bien sûr, la Suisse) continuent d'organiser un grand nombre de consultations populaires sur des questions qui ne sont pas liées à l’Union européenne. Ils sont suivis de près par de nouveaux Etats membres comme la Slovénie, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine, pour une raison plus générale. En effet, lorsqu'elles ont choisi leurs institutions après les changements de régime de 1989-1990, nombreuses sont les nouvelles démocraties qui ont inséré dans leur Constitution des dispositions concernant l'organisation de consultations populaires directes. Par exemple, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la République slovaque et l’Ukraine ont toutes prévu, en plus de la convocation de référendums par les gouvernements, la possibilité de consultations lancées par les citoyens, à savoir des initiatives populaires. En Europe occidentale, cette forme n’existe qu’en Suisse, au Liechtenstein et à Saint-Marin. Depuis 1990, les initiatives populaires – à l’exclusion du cas suisse – ont représenté seulement 13 % de toutes les consultations populaires organisées dans les « vieilles » démocraties, alors que dans les « nouvelles » démocraties d’Europe orientale et de l’ex-Union soviétique, la proportion augmente de manière significative jusqu’à 24 %. On voit ainsi que non seulement ces pays se sont dotés des dispositions formelles nécessaires pour organiser des initiatives populaires, mais que leurs citoyens en ont rapidement trouvé le mode d’emploi. Ces initiatives venant de la base y sont presque deux fois plus fréquentes que dans les anciennes démocraties. La différence est donc nette avec l’Europe occidentale, où les rares expériences de scrutins lancés par les citoyens ont eu lieu presque exclusivement au niveau local ou régional.
Enfin, pour mesurer l’impact de la démocratie directe, nous devons évaluer le succès des consultations populaires. Le « succès » peut prendre différentes formes. La première question est de savoir qui a du succès. Par définition, les auteurs des textes soumis à référendum sont les autorités politiques (le parlement et/ou le gouvernement). Si les électeurs approuvent le référendum, l’hypothèse est que ces autorités ont eu du « succès » et que leur proposition a été légitimée démocratiquement. Les initiatives populaires présentent le cas inverse, les dirigeants, qui y sont généralement opposés, recommandant de les rejeter. La deuxième question concerne les suites d'une consultation populaire. Même les référendums approuvés par une majorité d’électeurs ne sont pas obligatoirement pris en compte par le gouvernement, s’ils ne sont pas de nature contraignante (comme c’est généralement le cas). Les référendums favorables peuvent être aussi frappés de nullité lorsqu’ils n’atteignent pas un quota suffisant de participation des citoyens ayant le droit de vote. Dans ces deux cas, on assistera simplement à une prolongation du statu quo plutôt qu’à un changement de politique.
En partant d’un ensemble de données sur les expériences de démocratie directe rassemblées à l’université de Genève, il est possible de mesurer « l’effet net » des référendums et des initiatives populaires, c'est-à-dire de savoir s'ils ont correspondu à des changements politiques. S’agissant de l’Europe occidentale, la tendance a été à l'augmentation des taux d’approbation. Par exemple, depuis 1990, environ trois référendums sur quatre lancés par les gouvernements ont été approuvés. On relève aussi un taux d’approbation relativement cohérent (bien que légèrement inférieur) concernant les initiatives lancées par les citoyens, dont environ une sur deux a été approuvée par les électeurs. La plupart des consultations populaires – référendums et initiatives – étaient contraignantes ; pourtant, le taux de changement politique induit par le référendum a baissé. Plus récemment, seulement un référendum sur trois a débouché sur un changement politique direct, en dépit d’un taux d’approbation de 74 %. Autrement dit, seulement une proposition sur deux approuvée par une majorité d’électeurs entraîne un changement politique. Cette conclusion assez surprenante peut être attribuée à deux facteurs : premièrement, le nombre de référendums non contraignants a légèrement augmenté et, deuxièmement, les règles du quorum étant de moins en moins satisfaites, la participation des électeurs est insuffisante pour rendre le résultat juridiquement valable. Cette tendance inquiétante pourrait déboucher sur un cercle vicieux politique. En effet, si des consultations populaires sont organisées et approuvées, pour être ensuite ignorées soit parce qu’elles sont non contraignantes, soit parce que le quorum n'est pas atteint, l'apathie des électeurs ne fera qu'augmenter lorsque d'autres occasions se présenteront. Le fait de voter aux élections est déjà un acte irrationnel pour le citoyen dans la mesure où la probabilité que son vote modifie le résultat est minime. Malgré cela, ils sont très nombreux à se déplacer pour mettre leur bulletin dans l’urne. Mais, si nous ajoutons la probabilité que les résultats seront ignorés ou frappés de nullité par les dirigeants, la conclusion est pratiquement inéluctable : les citoyens deviendront de plus en plus apathiques et ne se déplaceront plus pour voter, d'abord lors des consultations populaires, mais ensuite peut-être aussi lors des élections ordinaires.
Le caractère non contraignant de certains référendums ne semble pas être le problème le plus aigu. Par exemple, lorsqu’en 1994 une majorité d’électeurs norvégiens ont rejeté l’adhésion de leur pays à l’Union européenne lors d’un référendum consultatif (non contraignant), il était politiquement inconcevable que le gouvernement norvégien ignore ce résultat et se prépare à adhérer à l’Union européenne. La même logique politique a joué pour le référendum consultatif organisé en 2003 en Suède sur l'introduction de l’euro. De ce point de vue, il n'y aurait guère à gagner en rendant contraignantes les consultations non contraignantes, sauf un impact potentiel sur la participation de l’électorat. Bien probablement, les citoyens voteraient en plus grand nombre s’ils étaient convaincus que la décision collective, quelle qu’elle soit, sera appliquée. Ce qui nous amène à la véritable question : celle de la fixation de seuils de participation pour les référendums et les initiatives populaires. Le résultat peut parfois être déterminé par une marge très étroite. Par exemple, dans un référendum organisé le 18 avril 1999 en Italie, 91,52 % des votants ont approuvé une proposition visant à modifier le mode de calcul pour l’attribution des sièges parlementaires afin qu’ils respectent mieux le principe de la représentation proportionnelle. La participation n’a toutefois été que de 49,58 % ; il manquait donc seulement 0,42 % des électeurs pour atteindre le quorum nécessaire de 50 %. C’est ainsi qu’un résultat massivement approuvé par les Italiens a été rejeté sur la base d’un seuil plus ou moins arbitraire.
La situation en Europe orientale depuis 1990 est assez différente. La très grande majorité des référendums et des initiatives populaires ont été approuvés. Les chiffres antérieurs à la chute du mur de Berlin montraient un taux d’approbation de 100 %. Toutefois, dans les régimes communistes, les référendums n’étaient pas organisés de manière démocratique et l’harmonie apparente entre les dirigeants et les citoyens était illusoire, comme le monde l’a découvert après 1989–1990. Les initiatives populaires, bien entendu, n’existaient pas. Depuis la démocratisation, non seulement le taux d’approbation a été supérieur à celui des « anciennes » démocraties d’Europe occidentale, mais les référendums se sont traduits de manière plus sûre et plus immédiate par des changements dans les politiques publiques. En quelques années, en Europe orientale et dans l’ex-Union soviétique, le rapport entre les référendums lancés par les dirigeants et leur approbation par les citoyens s’est rapproché de celui qui était la règle pendant le communisme, à savoir 100 %. On pourrait se demander si les gouvernements gagnent toujours parce que le processus de démocratie directe lui-même favorise ceux qui sont au pouvoir. Ce que nous savons de l'issue des initiatives des citoyens nous laisse penser que ce n’est pas le cas dans ces nouvelles démocraties. Confrontés à des choix qui s'opposent généralement à des politiques existantes et exhortés à voter « non » par leurs dirigeants, les citoyens récemment affranchis d’Europe centrale et orientale ont en effet voté « oui » presque deux fois plus souvent qu’en Europe occidentale.

